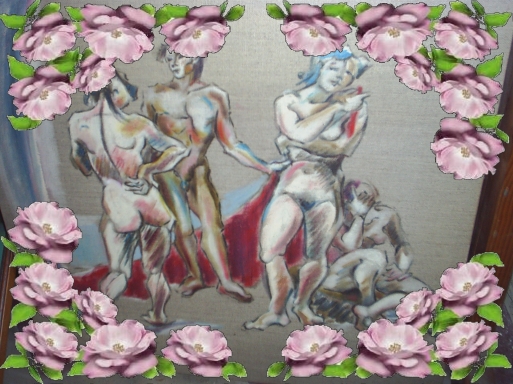der grüne Affe - Page 56
-
-
APOLLON
COLLIGNON DESCRIPTIONS CARTES POSTALES
(LA) TETE D'APOLLON DU MUSEE D'OLYMPIE
Rude tâche. Rude car tant d'autres avant nous s'y sont essayés.
Avant que cette tête ne disparaisse sous la culture de masse (humour islamiste),
admirons donc.
Tâchons de ne point défaillir devant cette magnifique coupe au bol ceignant
voluptueusement ce front bas, admirons le lisse de ce marbre qui semble appeler
la caresse, du regard.
"Ne - touchez pas - à la - statue" des yeux seulement. Le nez droit, la bouche
sensuelle, et les yeux vides : c'est une erreur d'avoir tardivement tracé
l'iris et la pupille, réduisant "l'amour" à "l'amour d'Alfred".
Le méplat du côté droit trace un arrondi de mâchoire d'une particulière
puissance. Les oreilles restent juste recouvertes par les boucles.
La chevelure est en accroche-coeurs pressés, tressés et rapprochés
à la "crinière de cheval". La tête' blanche est tournée vers nous de trois quart
et regarde loin, divinement, à notre gauche.
Il porte à l'endroit du coeur un trou en vulve horizontale. Vers nous l'amorce
d'un drapé, plus au fond celle d'un autre apparemment, car le pli
de l'aisselle n'y correspond pas.
C'est froid, c'est beau, inhumain, divin, inexpressif, plus propre à l'autorité
qu'au désir. Nous attendons en ce moment l'éclipse partielle qui privera
le monde sur cette aire de balayage de 60 à 70% de son intensité ;
les pépiements se font rares, appréhensifs et nocturnes.
Notre Apollon se détourne de nous. Son nom serait plutôt celui
d'un enclos d'épines, où se réfugient les moutons
pour la nuit. Les proportions sont parfaites. Le marbre est d'un cireux
resplendissant. Le tout dégage une puissance, une indifférence, un dédain
pur la menace, qui est bien celui d'un homme, au sens viril du terme.
Et il n'a que vingt ans. S'il baise à vingt ans déjà comme cela, ce sera
très bien vers les quarante. Et quand on en a fait le tour, en passant par
le haut du crâne aplati, on en a fait le tour, il n'y a plus rien à dire.
Juste à ouvrir les cuisses en se laissant faire, en serrant les siennes,
de femme, contre son dos. En même temps, les parois du vagin de resserrent
sur la queue du dieu, se relâchent et se recollent jusqu'à l'orgasme, sans qu'on
sache très bien si c'est le décollement ou le resserrement qui l'augmente
le plus. Il me semble que je suis femme.
Et qui baiserait e dieu, qui le ferait jouir, lui qui possède le plaisir
de l'éternité, lui pour qui l'orgasme humain serait déchéance ? Lui qui
jouirait, déchargerati en pensant à autre chose ? La femme pense à autre chose
("Avez-vous pensé cher ami à bien remonter la pendule ? - Such a question
in such a time ! " De surprise mon père lâcha sa semence, et c'est ainsi
que je fus conçu, moi Tom Sawyer, Tom le Scieur.)
Apollon, Dieu du Soleil, s'éclipsera ce jour à 10h25, en coïncidence
avec le printemps. Sonia me téléphone, et nous échangeons des précisions dites
scientifiques. Nou sessaierons aussi de lever notre précieuse épouse.
Hier nous étions clinique Tivoli, où notre ami à la barbe solaire gît
sur son lit d'hôpital, tandis que sa femme trône, seins et ventre en relief,
derrière une table roulante chargée de mots croisés : Balcon sur la mort.
En pleine forme, la veuve, avec son cancer des deux seins. Leur fille est venue,
droite, sèche, veuve. Se trimballant de gîte en gîte, ayant décidé
depuis ce veuvage de ne plus avoir de domicile fixe mais de se faire héberger.
Que c'est une frôle de bête qu'une femme indépendante. Je me demande
si je suis sorti du sujet ? pas du tout. Apollon est virilité. Froide,
insaisissable. Abstraite aussi est la féminité, en d'autres statues
tout aussi blanches en marbre de Paros. Apollon ici se détourne. Sa menace,
ou son observation, se dirige sur une autre cible. Rien de plus pernicieux
que les rayons du soleil, qui dardent sur le cerveau le fléau des insolations.
Répète après moi : je suis le meilleur du monde, et il ne m'a rien manqué
d'autre que la magouille et l'occasion pour tomber sous le faisceau
du Célèbre. Qui saura faire bouger les traits et le cou de ce robuste
jeune homme ? Je désire Dieu. Dieu me désire-t-il ?
La tête est jointe au col par une cicatrice continue de décollation.
Les tavelures apparaissent au-dessous de la ligne des épaules. Peut-être la tête
est-elle replâtrée.
-
Le Corbeau du Puch
COLLIGNON LE CORBEAU DU PUCH
1. La nuit, la neige
La neige durcie se boursoufle en dents de scie. Sale. Au pied du réverbère bleu. C'est poreux, ça crève en bulles, le vent siffle.
« Il va geler ».
Vis-à-vis, sur le mont, entre les sapins : des lignes de neige. Comme le cuir, sous les cheveux.
L'adolescent mains dans les poches, voûté. Il monte la pente. Un chien souffle sous une porte en bois. Jean-Pierre s'est appris à ne plus sursauter.
Au sommet, la Tour du Puch, un banc dans la nuit contre la muraille, Jean-Pierre s'assoit pour surveiller la ville loin dessous. Des murs de lave, abritant les baises et les filles attentives, assouvies.
L'adolescent les imagine.
Elles ne le désirent pas.
Il a des traces sur la peau.
Il reconnaît d'en haut tous ses itinéraires, toutes les nuits, rue du Rouëre, des Chanoines, avenue Six-Moines, avec des lits, des entrepôts, chez lui. Le Puch, ville historique du Limousin- sans Histoire il veille sur les habitants du Puch. Les Puchéens. Les Puchéennes, les tabliers, les caniveaux. La Tour se visite tous les samedis, et le dimanche, 7 F50, il y est monté pour voir quelques hectares de plus. « Je suis curieux » dit Jean-Pierre.
Le garde vit derrière ses murailles. Il se couche tôt. Il ne meurt pas. Il ne monte plus au sommet pour surveiller les visiteurs. Il dit :
« Ne vous suicidez pas ! »
Personne ne se suicide.
Le vent forcit. Les aiguilles crissent : toutes les nuits le garde entend crisser les trois aiguilles sur le grand cadran lumineux. Jean-Pierre descend par le versant de l’ouest, la boue gèle et dégèle, ses pieds glissent sur les degrés, le crépi des murs lui racle le coude, les portes vermoulues donnent sur le vide.
La pente casse net sur la place de l’Euse, un parapet donne sur la rivière qui bout très froide sous les lueurs bleues de la ville. Jean-Pierre se retourne, s’accoude au parapet. Face à lui la vitre jaune dépolie du Café-Bar, toute la menace de sa vie - « Trouve donc du boulot ! au lieu de traîner... » - des Filles, des Jeunes, des Autres.
« Je ne suis pas de ceux de mon âge.
Sous lui l’écoulement de l’eau ; par devant, le bruissement de la vie.
L’adolescent palpe dans son dos « ses amies les pierres ». Il fait de plus en plus froid.
Jean-Pierre passe en revue les bisrots du Puch sans entrer ; de l’autre côté de ces vitre dorées, la musique, l’alcool (...)
2. Ma sœur – La rencontrer
Mathilde l’attend pour manger - « ...au lieu de traîner ! » , comme elle dit.
Jean-Pierre avise sur le trottoir une Jeune-Fille. Elle a de belles jambes. Fille, jambes, trottoir.
« Mesdemoiselles, vous ne serez jamais inquiétées si vous montrez bien où vous allez. L’air décidé. Marchez d’un pas sec. »
Jean-Pierre la suit, se glisse dans ses pas, sans bruit, sans rouler des épaules. Ils passent devant deux sapins déplumés, de part et d’autre de l’Hôtel de Ville – l’an dernier, on les a laissés là jusqu’en avril.
La Jeune-Fille a des cheveux noirs. Jean-Pierre se demande s’il a l’air naturel. « Tout à fait naturel » dirait-elle en se retournant. Il lui demanderait :
« Comment faites-vous mademoiselle en plein hiver pour aller en jupes courtes, moi je me gèlerais les…
Les…
Elle prendrait ça mal.
Il pense encore :
« Ce n’est pas que je n’ose pas. Je refuse. Voilà : j’ai renoncé aux femmes.
L’émancipation de la femme, ça le fait bien marrer, Jean-Pierre.
Ils sont passés devant l’affiche du cinéma :
Le Puceau se déchaîne.
C’est malin.
Silence dans les rues. Juste les coups de vent par-dessus les murs ou qui se glisse dans un doigt. La Jeune-Fille monte trois marches vers la rue Bragard. Il pose sa main sur la rampe de fer qu’elle a touchée, embrasse le creux de sa main. Au-dessus de lui la fille s’est retournée : il a compté une marche de trop, son pied a claqué sur le trottoir. Il a mis un genou en terre et les bras en croix pour garder l’équilibre.
« Tu ferais mieux de trouver du travail répète sœur Mathilde. Au lieu de bouquiner !
La Jeune-Fille est rentrée chez elle. Jean-Pierre court à sa porte. Les verrous claquent. Celui
du haut, celui du bas. Un troisième, plus profond, en bout de couloir. Jean-Pierre s’approche, lit le nom sur la plaque en cuivre :
M. et Mme BARDIN
et leurs enfants
« Et leurs enfants... »
Jean-Pierre retient l’adresse.
3. Ma sœur - La peinture
Chez lui, Jean-Pierre peint : des seins, des fesses, sur toute la surface de la toile. Des fesses vertes, au couteau. Il entasse des couches de blanc, de crème.
« ...de chercher du boulot. Qu’est-ce que ça va te rapporter ta peinture ?
- Bonjour sœur Mathilde.
- Qu’est-ce que ça représente ?
- Des culs.
- Tu te crois malin.
- Je ne sais pas ce qu’il y a dedans.
- On mange dans cinq minutes. Et tâche de ne pas te faire attendre. Ton père est là aujourd’hui.
- Pourquoi, ce n’est pas le tien ?
L’atelier occupe un ancien garage. Il y fait sombre. Un palan, quelques clés, plates, à pipe. Jean-Pierre se place sous la lucarne, couverte de crasse. Il faudrait un couvreur, avec une grande échelle, pour la gratter.
« Je ne vais plus rien voir ». « Je vais devenir aveugle ».
Il se lève, jette un coup d’œil à sa toile : des chairs tordues en diagonale. Rose gras, blanc mou d’un corps sur l’autre, une purée de ventres, de seins ventripotents.
- À table !
4. Le père, la soupe
Le père est là, c’est un petit chauve, tout gris, qui lampe vite son potage sans lever la tête.
Jean-Pierre contourne la table pour l’embrasser. (Mathilde répète à son frère tu aimes ton père, toi). Jean-Pierre se sert en soupe en haussant les épaules. C’est rare que le Père mange ici, 3 rue des Moines. Mathilde porte lentement la cuillère à sa bouche, qu’elle ouvre grande, les yeux vagues, le geste grave et moi. Jean-Pierre n’entend que le sifflement intermittent du radiateur au thermostat. Tout est bien rangé. Elle file doux, la Mathilde.
Le Père pousse son assiette, sans dire un mot. À cinquante ans, il fait déjà vieux. La Mathilde le ressert – il ne vit donc que de soupe ?
« T’as trouvé du travail ?
Jean-Pierre lui poserait la même question.
« ...faudra s’en occuper, dit le Père.
Ils prendraient son argent. La sœur et le vieux.
« Toute sœur éprouve pour son frère un attachement inconscient, qui peut aller jusqu’à l’inceste » - « Y aurait plus qu’à se flinguer ».
- Tu dis quelque chose ?
- Rien, rien.
- Il se rendra fou avec ses lectures. Si t’étais occupé de tes mains au lieu de fainéanter.
- Ça suffit Mathilde.
Son père ne regarde jamais en face.
« Écoute-moi bien Jean-Pierre… Je vais partir huit jours à Châteauroux... » Mathilde sursaute. « Tu vas me faire le plaisir de trouver du boulot. N’importe quoi. Tu m’entends ? »
Châteauroux… Châteauroux… Qu’est-ce qu’il veut que ça me foute…
M. § Mme BARDIN
« Et leurs enfants »
…………………………….
5. Correspondance
« Monsieur,
J’ai à vous apprendre que votre fille... » - qu’est-ce que je peux bien lui apprendre sur sa fille ?
Trois fois. Elle a tiré les trois verrous. Le dernier plus profond.
« Monsieur,
Votre fille, que vous croyez si chaste... » « ...si chaste et pure... » « Votre fille se… se... » -
- il serre les dents.
- Qu’est-ce que tu as ? Qu’est-ce qui te prend ?
Il a appris cela. Par intuition. Par déductions. Par enquêtes. Ce qu’il fait seul. Elles le font aussi. Elles le font toutes. Lui aussi le fait. Mais ce n’est pas pareil.
« Pas pareil. »
« Je ne fais pas la morale, moi. Je ne refuse personne. Elles me refusent. Elles refusent tous les hommes. Elles leur font la morale. Puis elles rentrent chez elles, et elles se… se... »
Révoltant. C’est révoltant.
« Elles croient toutes qu’on va les violer ».
- Je vais dans ma chambre.
- N’oublie pas ce que je t’ai dit ! crie le père.
C’est une pièce encombrée de meubles et de tiroirs.
- On les montera au grenier, un jour.
En attendant, tous l es jours, Mathilde les astique, obstinément.
« Tiroir 12. Enveloppes.
« Bardin, 23 rue Blagard.
- Tous ces couillons qi prennent les filles pour des rosières... »
Monsieur virgule (« Chère mémé virgule ») - c’est le vide ; soudain le stylo s’emballe, comme un grand trait de phrases qui s’ébranlent, ordurières, dérisoires, emphatiques.
Précises. Anatomiquement très précises.
« Signé M., chirurgien-dentiste »
« Signé C., noaire. »
Il trace un grand « F » en cou^p de sable – le reste illisible.
« Ça fait moins… ça fait moins anonyme ».
Il place la lettre sous sa chemise, contre la peau du ventre. Il se voit traîné sur le Boulevard Laudry, dans une charrette, la tête et les poignets dans un carcan ; des gendarmes à cheval, en tricorne, qui l’escortent, le désignent aux outrages.
L’écriture est nerveuse, régulière. Il ajoute quelques barres de « t ».
6. Tempête sous un pan de chemise.
« Où vas-tu cet après-midi ?
...Mahilde adossée à l’évier ; les assiettes mal rincées qui sèchent sur l’égouttoir.
- Chercher du travail.
Mathilde pousse un ricanement.
Jean-Pierre passe par le garage. La lucarne. Un file d’eau noirâtre a tracé une rigole sur la toile.
« Bordel ! Je ne pourrai jamais rattraper ça.
Il repousse quelques cadres à l’abri. Quand il se baisse, l’enveloppe lui gratte la peau, sous la chemise.
L’air est cru, la Mob encrassée. Passé le mur d’usine, le froid vient vous trancher. Jean-Pierre respire largement. L’air glacé se faufile sous les vêtements. Seul point chaud,le ventre, sous l’enveloppe.
« ...et si je cherchais vraiment du travail ?
Jean-Pierre tend le pied à ras de sol, pour contrôler le verglas. Quant il était enfant, il aimait bien poser le pied sur une bouse à demi-séchée. La croûte séchait, le pied s’enfonçait, les mouches bourdonnaient – ça puait vachement !
Des hameaux. Des portes. Les boîtes aux lettres. Une fente, aux lèvres coupantes – étroites blessures du bois, du fer, du ciment – celles des garages, immenses, chromées, ou bien les boîtes perchées, frileuses, aux grilles des jardins.
« C’est une honte ! » hurlerait la Jeune-Fille. Une fille normale. Qui ne pense jamais à ces choses-là. Qui ne sait même pas que ça existe. Au moment donc où la Jeune-Fille, ivre de bonne foi, serait sur le point de convaincre, où le père s’apprêterait à chiffonner la Lettre Anonyme, à ce moment-là, lui, Jean-Pierre Fargey, ouvrirait la porte d’un coup de botte ; la fille tomberait à genoux. Il se ferait sucer.
« Merde ! »
La mob qui zigzague.
« Je trouverais du travail. Je me marierais. J’aurais trente ans. Il y aurait du soleil, une prairie, un enfant » - et soudain, sortant d’un petit bois rabougri, la plaine de neige grise – il va jusqu’à Saint-Vital. Des toits bruns, blanc sale. Un paysan passe en tapant ses bottes.
Une boîte postale est accrochée, là, devant ses yeux, dans un virage. Une immense palpitation se déclenche dans sa poitrine – cela descend tout chaud tout moite au bout de ses doigts – comme lorsqu’il avait brisé un jouet, tué un chat – commis quelque chose d’irréparable ; il ne resterait plus qu’à attendre le châtiment, terrible, avilissant (…)
Ses pommettes cuisent.
Son cœur serré.
Jean-Pierre a tiré l’enveloppe
« Dernière levée, Mercredi 10h »
- sa main s’élève vers la fente. Il ne regarde pas. La lettre est tombée. Aussitôt le sang revient frapper ses joues.
Personne ne l’a vu.
7. La mère
« Ta mère était une grande malade.
Mathilde coud. Elle porte un tablier blanc. Jean-Pierre prend sur la table une paire de ciseaux. La pièce est trop haute, mal repeinte.
La mère se plaignait toujours. Elle prenait des cachets. Des comprimés. Mathilde lui faisait des piqûres. Jean-Pierre se pique les doigts.
« Rends-moi les ciseaux.
- Tu as dit « ta mère ».
- Ça s’est trouvé comme ça.
- Tu l’as connue avant moi.
Mathilde coupe le fil avec ses dents.
« Qu’est-ce que ça fait, d’être fille unique pendant dix ans ?
- Qu’est-ce qui te prend ?
Mathilde lève la tête. Une grosse tête blême.
Elle a dit que la mère était plus gaie, « avant » ; que c’était une vraie « boute-en-train ».
« Dans les repas de famille, elle faisait rire tout le monde.
- On ne fait plus de repas de famille, dit Jean-Pierre. Il demande :
« Tu sais quelque chose, pouor Châteauroux ? »
Mathilde range son matériel de couture sans répondre :
« Épluche-moi des patates. »
Il prend un torchon sur ses genoux.
- Tu crois qu’elle est…
- Partie. Je te l’ai déjà dit. Avec un gendarme. Elle vit avec lui.
« Pourquoi me regardes-tu comme ça ?
- Tu as son menton. Exactement son menton.
Jean-Pierre se lève le couteau à la main, il se regarde dans la glace au-dessus de l’évier. Traces de varicelle.
- Aide-moi à mettre la table. »
Les traits de Mathilde retrouvent graduellement leur expression de haine cuite.
Les petits yeux de Jean-Pierre se rapprochent sous son front de papier mâché.
Au transistor la musique est bonne. Ils évitent de se parler.
8.- Nigth Clube
Le bar de la rue C. « rouvre ses portes après rénovation ». Nigth Club – le « th » anglais, sans doute. Je n’y mettrai jamais les pieds. C’est pourtant facile, Jean-Pierre : tu te faufiles dans un groupe. Tu t’assois là, près de la porte, sous les patères.
Il entre, en ligne droite, jusqu’au bar :
- Un café.
Le barman a son âge. Il fracasse des bouteilles vides à ses pieds, dans une lessiveuse.
- Plaît-il ?
- Un café.
Le barman se mord le pouce. Il s’est écorché. Bien fait pour sa gueule. Il se tourne vers le percolateur.
Trois rustauds arrivent. Ils se perchent sur les tabourets. Le barman rigole avec eux. Jean-Pierre rigole. Tout le monde rigole. La nuque du barman forme un petit bourrelet. Le dos tourné, il répond aux railleries avec assurance. Il a monté l’affaire avec deux amis. Il vide les poubelles, il fait le ménage. Jean-Pierre dit :
- Vous ne pouvez pas me servir quelque chose par là-bas ?
Il désigne le plus négligemment qu’il peut une tenture à gros plis, derrière laquelle on devine un escalier qui descend. Le barman regarde sa montre, prend les autres à témoins :
- Pas avant une heure !
Les autres approuvent avec ensemble.
À travers les pans de vitres passe un petit courant d’air. Un enfant se dirige vers le flipper. Des apprentis se réunissent quelques minutes autour de trois canettes de bière. Jean-Pierre boit encore, observe les parois crépies, les appliques de plastique, le comptoir chromé.
Vers le fond, des tables rustiques.
Il se sent bien.
Il n’a plus peur.
C’était un jeu.
Commander un lait fraise, un café, blaguer avec des inconnus – la Grâce, l’Instant.
...D’un coup, l’ouverture, tourbillon de rires, des femmes – de la neige – parfums – fourrures.
- Salut !
- Salut !
Elles se jettent au-devant des baisers toutes frissonnantes, les épaules relevées.
Jeannine, Laurence ou ce genre – les cuisses coupées par un galon de lapin. Des cuisses fortes, comme greffées ; elle se penche sur le bar – mollet tendu, couture du bas, bise au barman - « attention aux verres ! »
Par derrière Jean-Pierre sent la pulsation du juke-box, le poids des pièces qui tombent, les hommes dans son dos pendent les manteaux, près de ses épaules, les battements de la porte jamais tout à fait fermée -
Il commande une cerise.
- Bonsoir Joël – Bonsoir Josy - ...Judy » - bises, bises, « permettez pour la chaise ?
- MAIS BIEN SÛR.
On lui a adressé la parole. On lui a adressé la parole.
Il n’y a pas que les ennemis.
Il y a aussi les indifférents.
Les filles sont sympa.
Les filles aux yeux vagues, blotties sur la banquette – la fierté apprise du regard – mâchoires fortes et cheveux gras – des jours au fond des salons de coiffure, des saisons au fond des magasins de chaussures – hinhin les rires niais, les lèvres retombantes -
- Jean-Pierre, tu fais le difficile.
Une demoiselle qui bat la mesure du bout de son soulier.
Une demoiselle qui tourne la tête vers lui, vers les jeunes hommes si différents -
J. F. bonne fam.
Délurée, exc. éduc.
ch. H.
bien sous tous rapports
- elle est ivre, un peu, et lui plaît,beaucoup^.
Jean-Pierre a les yeux louchons, le nez tombant, le teint brouillé, les cheveux raides.
Il ne se lave pas très souvent.
Près de la grande fille blonde et flambant neuve, c’est une vierge terne aux yeux torves, aux dents fâcheuses, au nez...- on commence ? on commence ? On est dix, au moins ! »
Derrière le rideau plissé une lueur rouge, très « boîte ».
Au juke-box ont succédé des accents lourds, pleins, plus graves. Les autres se lèvent.Jean-Pierre leur emboîte le pas.
« Vodka orange ».
Comme les autres.
Du rouge, du noir, le feu en plastique dans la cheminée, les filles, les voix – la musique – les autres qui dansent. Lent, rapide, lent. Spots rouges pour la batterie, jaunes pour les guitares, noir pour le silence – le bras par dessus la tête
béat, béat, béat
« ...et des sèches s’il vous plaît »
Passé le cinquième verre je laisse tomber
- Eh bien, le grand ? On ne danse pas ?
La délurée vire déjà au bras d’un bellâtre. Il ne reste plus, assise, que la vierge grise, elle dit :
« On y va ? »
Comme à la piscine.
Il la prend dans bras et gagne la piste – dadin, dadon – dandin, dondon – c’est le slow, le slow bien noirâtre. Il la serre, il la sent de très près sur le cuir chevelu, la musique joue, elle ne l’entend pas renifler que dire, que dire - « Allez, on le fait celui-là » - c’est le slow suivant – dadadon- dadindon – comment ça se tient, une fille ?
Et pas moyen de bander. Paraît que ce n’est pas obligatoire.
« C’est ma cousine ! crie la délurée. Toujours au bras du même. « Faites-en ce que vous voulez, mais surtout pas un petit !
C’est pas vrai. Non mais c’est pas vrai.
Il se voit sur un chemin ensoleillé, tenant une fillette par la main – quelle publicité, déjà ?
Ça sent le cuir chevelu. Ça sent l’humain. Voilà bien longtemps qu’il n’avait pas senti un être humain de près, il humagine dans le noir les racines serrées piquées sur le scalp blême, les « glandes sudoripares » - je te plais comme je sue ?
Il ne peut pas l’embrasser sur le front ; elle est trop petite – mais que dire, que dire – j’ai trouvé :
«Mais c’est notre cher Johnny ! » - la bouche en coin.
Pas dupe.
Elle dit oui.
Par quel bout on commence d’habitude ? Si je ne flirte pas tout de suite…
Que se passerait-il ?
Ils se rassoient. « Tu veux une vodka ? »
Non.
Et rien à se dire. « On ferait mieux de se taire ».Il le lui dit. Chapeau. Chapeau. Des icebergs ans la tête. Il offre une cigarette. « Vous ressemblez à votre cousine », dirait-il. « Elle vous jette toujours dans les bras des types,comme ça ? ...vous couchez ensemble ? »
« Boïng, boïng », dit la musique. « Ploc, ploc », font les spots. La fille se tait. À côté, sur la banquette, la cousine délurée s’est éméchée :
- Si une fille tire un coup… Quand une fille veut tirer son coup…
- Elle réussit son coup à tous les coups, dit le bellâtre.
Jean-Pierre pense que de toute façon, les filles préfèrent rester seules.
- Je me comprends.
Il fume. Il boit. La fumée le soûle plus que l’alcool. La fille, de plus en plus raide, attend qu’il parle.
- Je hais les timides. Les timides vous paralysent. Pas moyen de leur adresser la parole.
Ils ne dansent plus. Les autres se lèvent, tournent sur la piste, reviennent s’assoir, leur passent devant – la cousine lui tombe sur la poitrine – Avec elle, ce serait plus facile.
La vierge tire de son sac à main le calendrier du RCP : le Rugby Club Putéolien.
« D’où tu sors cette horreur? »- c’est parti tout seul – il lui dit « D’où tu sors cette horreur » - son frère, son cousin joue dans l’équipe, elle est fière de lui - « C’est lui qui talonne elle dirait, c’est lui qui a droppé, qui a transformé
« Ce n’est rien », dit-elle d’un petit ton contrit, ce n’est rien.
-
Le Cloître
C O L L I G N O N L E C L O Î T R E
Il était parvenu à cette espèce de satisfaction. Voyant autour de lui la vastitude des campagnes, les prés, les bois et tout ce qui s'ensuit (vaches, femmes dans les bourgs et draps sur l'herbe), il se sentait le possesseur, l'englobeur des choses. Ses poumons se soulevaient, il absorbait les champs, le val, un clocher ruminant sur Volsonne, et les fumées au loin vers Waldebourg. Son souffle passait sur les blés, les haies, les potagers : l'abbaye profitait de tout, la natalité galopait, la longévité longéviait. L'abbé Jean-Robert enrobé dans son embonpoint succédait à l'abbé Jean le Loup. Le successeur à présent régnait sur mille arpents de vignes, de villageois et de rivière, et s'appliquait volontiers l'ironie.
Vingt ans auparavant, anno Domini quatorze-cent soixante-sept, il était entré là, par un sombre jour de neige ; il ne tombait du ciel qu'une grande grisaille de lumière ; le fils cadet du rempailleur n'avait pas suscité de miracle à St-Cloud-d'Ambervilliers. Les jeunes femmes ne l'amusaient pas, les vieilles non plus. En bref sa bite molle le faisait chier. Finalement il se sent fait pour des choses plus nobles. Plus longues, tiens, justement. À la mesure de ces bâtiments noirs, très lourds, avec des ardoises très noires jusqu’à mi-sol des murs, et des cheminées à rôtir des sarrasins.
Il en habite un, au sommet d’un monticule sans excès, dont l’abbaye occupe tout le plateau. En dessous, dans toutes les directions, des vallonnements vachement fertiles.
Sous la neige (c’est janvier) le Frère Ikselles, mort depouis, montre à l’impétrant 1) le réfectoire, 2) le cellier, 3) les dortoirs. 4) la bibliothèque et les commodités. Plus les parchemins attestant de la fondation de l’abbaye en l’an de grâce 909 (CMIX). Et très vite, vingt-huit ans à peine avaient suffi à Jean-Robert de Baume pour conquérir les têtes, les cœurs et les confiances, si bien que ses pairs applaudirent à sa désignation par le pape Léon VII : abbé de St-Cloud d’Ambervilliers.
La vie de moine passe comme un jour, la règle empêche qu’on se voie mourir, empêche qu’on se sente vivre. Mais Jean-Robert de Neuzanville n’était pas un abbé ordinaire. Il parvint à se faire attribuer, en sus de son réduit réglementaire, le rez-de-chaussée d’une tour où s’ébattaient jusqu’ici volontiers les volailles – en bref un ancien pigeonnier où promptement s’aménagèrent trois étages. Les fromages se vendant, les aménagements intérieurs permirent à l’abbé une bonne retraite. Il n’était ni mieux chauffé, ni mieux nourri, mais pouvait ainsi s’appliquer la devise de Sénèque :
Sanabimur, si separemur modo a cœtu -
Nous serons guéris, à condition de nous éloigner de la foule.
C’était un haut homme, puissant, sanguin, bien proportionné. Il lui fallait cet air des cimes, disait-il en riant, pour appliquer à son gouvernement la lucidité indispensable. Le jour où le Frère Ikselles intronisa ce nouvel homme en ces lieux, je me suis méfié. Les distractions sont rares dans les monastères, à moins de se réjouir de la régularité liturgique. Je me suis fait espion. Malgré l’interdiction j’ai tenu un journal où je notais tous les faits et gestes, et les pensées de Jean-Robert. Déjà, on l’a castré du Neuzanville. Puis il a demandé de lui-même à se faire instruire de la vie de saint Robert, Rien pour moi-même, tout pour les autres. Il a juré entre ses dents. Il s’est signé. Qu’a-t-il vécu dans sa vie « d’avant » ?
Il n’est poussé par nulle vocation. Il aurait mieux caché ses réelles ambitions. Mais ses dents dépassaient aux commissures. Toujours à côtoyer le chef de notre communauté, à le narguer sitôt le dos tourné. Toujours à rudoyer le novice : gueuler sur le coupeur de bois, l’homme des seaux de lait, l’homme des vaches.
Il a senti, très vite, que ça se voyait. Il s’est donc appliqué à la transparence, à la discipline et aux mortifications. Il avait parfois dans les yeux des lueurs, et du verdâtre au creux de ses joues. Certes, il n’était pas aussi rouge qu’aujourd’hui. Il ne soufflait pas en montant les escaliers. Je ne susi jamais arrivé à le trouver désagréable : Dieu aurait pu, s’il l’avait voulu, me créer à l’image de Jean-Robert ! qu’il me pardonne mes pensées sur mon propre abbé.
L’abbé Jean-Robert s’éloigne de la fenêtre sur le vallon. Il s’installe sur un prie-Dieu, au milieu du cercle de pavés rouges. Dieu voit tout.
« Je me souviens » pense l’abbé -peu enclin à penser en ce jour - « d’avoir été le seul depuis saint Jean le Loup à présenter mes intentions, dans un discours préliminaire : le rescrit.
« Nous avions bien bu » poursuit-il. Du bon vin dans des brocs tout simples. Des discours, en latin, en allemand. Je m’en suis trouvé exalté. C’était aussi comme un grand puits de lumière, irradiant tout mon intérieur, canalisation divine, faille de tous et de chacun. Je pouvais à volonté ouvrir ou clore la plaie de tous mes amis et frères, au nombre de 72, 6 fois Douze. Ils m’obéirent tant, que j’en fus confondu. La Grâce est terrifiante. Enfin le puits disparut. »
Jean-Robert priait peu. On le voyait soucieux, le vert au creux des joues. Il inspectait partout, redoutable. Il contrôlait qui se confessait, qui non. Muni de l’indult papal, il eût prospecté le secret
des confessions. Puis il se renferma de plus en plus souvent. Et le renfermement ne va pas sans une extrême conviction que tout est Vanité. C’est assurément le but du moine : certains s’affligent, d’autres s’enflent d’orgueil ou de désespérance, mais les meilleurs sont tentés par l’absurde Vacuité du monde. Je peux vous en parler : ils m’ont renvoyé trois fois.
Jean-Robert s’affligeait : n’être qu’un abbé, c’était du petit monde. Il avait inventé le recroquevillement d’Envie. Il se rabattit sur nos boutonnages et sur nos laçages, souliers d’hiver, sandales d’été. Ah ! c’était un drôle d’abbé.
Jean-Robert s’infligeait des pénitences. Il se cognait la tête aux murs, ou de ses poings. Il restait à genoux des heures. Il ne s’agissait pas d’élancements mystiques. Juste une question d’organisation. Apparemment. Il humiliait à heures fixes sa chair abondante et gourmande. Avec méthode, il se flagellait quelquefois.
Quant au frère Ikselles, il se chargeait des contacts extérieurs : Monsieur de St-Dié. Frère Ikselles n’eût jamais révélé ces bagatelles à quiconque. Au bout de trois minutes de flagellation, l’abbé Jean-Robert transpirait comme un fleuve. Il s’était appliqué à méditer sur Dieu, sur le Fils, saint Joseph ou Marie. Mais il eût estimé ridicule ou fâcheux d’atteindre l’extase. Il s’essuyait avec un gant de crin, et mangeait du poisson toute une semaine. Scrupuleux donc, à sa manière dure envers les autres et lui-même : à genoux sans coussin devant l’autel, soit ; jeûnes fréquents, soit. Mais ne jamais couler dans les excès de Remiremont, sous la cornette ithyphallique de Mère Cécile-Andrée de Bonnefont.
Frère Ikselles était le seul à se souvenir des sœurs « bonnefontaines ».
Cependant, cependant :
La cellule du Père Supérieur Jean-Robert ouvre sur une Bibliothèque largement pourvue en exégètes de Bouddha. Il en a tiré une philosophie tout à lui, qui ne retient -de façon élémentaire ! - que « l’affirmation du néant, qui est Dieu ».
Il vit profondément de cela.
Il s’affine vers Dieu.
Dans ses méditations paumes levées, il tente le Grand Sommeil, qui est connaissance suprême. Par la rupture avec le lien charnel, ca grand corps accède aux ciels purs. Quand il déplie ses jambes en lotus où passent les fourmis, Jean-Robert sent s’épancher au sommet de sa tête une insondable torpeur.
Comme un coup de masse de bronze.
Il se sent apaisé, descend donner des ordres d’une voix angélique et veille à tout son monde avec des effleurements de cristallier. Il s’efforce de voiler ses élans de fierté. Il relit les passages sombres de Job et de l’Ecclésiaste, et se retrouve chrétien comme devant.
Rien ne lui semble plus important que l’étude de soi-même.
Rien ne lui semble plus important que de le rejeter.
Ne plus manger. Ne plus bouger. C’étaient les derniers temps de son séjour à l’Étage. Il aspirait, bloquait son souffle et répétait aum d’une voix caverneuse, tenue le plus longtemps possible.
Ses entrailles cérébrales frémissaient.
Il s’absorbait, tout de même, devant le Christ en Croix.
Malgré ces macérations, les jeûnes et les privations de chauffage, il sentait persister en lui de vieilles attitudes, raisonnements vicieux, jugements erronés et attributions de beaux rôles. Ces stupides persistances, pourtant, lui étaient gages de sincérité : le Père Jean-Robert, immobile, croisées ouvertes, se sentait parfois satisfait de ses insatisfactions.
* * * * * * * * * * * *
..Zachée, quant à lui, s’étourdissait de chasses. Rien de plus facile dans ce pays-là : au pied des montagnes, chaque vallée contenait de l’ours, du cerff et du faucon bleu. Ou bien du lièvre, des perdrix.
Plusieurs fois par semaine, Zachée de Broisy sortait son équipage, chevaux, chiens d’Artois et bâtards. Il chargeait son dos de flèches, son poing d’une pique ou d’un épieu à l’ancienne.
Comme dans la chanson, « la venaison garnissait les saloirs ». Bien sûr il s’ennuyait comme une bête, et les festins lui rappelaient avec remords les vertus de Jean-Robert, Prieur de St-Clothy d’Ambervilliers, dont la renommée avait franchi les 50 lieues qui séparaient le Mont Clovis de ses domaines.
Surtout, Zachée de Broisy connaissait des difficultés sans mesure avec l’administration départementale du Jura, parce qu’on n’avait pas idée, en 1883, de chasser « à la médiévale », quand les meilleurs fusils étaient en vente partout, nom de D. !
C’est pourquoi Zachée de Broisy sanglotait in petto en considérant le vénérable Jean-Robert de St-Clothy, cousin par alliance de sa première femme. Zachée essuie souvent sa barbe, grasse, courte et drue, comme obscène, comme plaquée. Toujours humectée. Courteau, de joues renflées, rose et potelé des doigts, suffisamment agile pour jouer du serpent. Mélomane, lui faut-il vraiment renoncer à toute la boursouflure de la vie par désir d’amour divin, de Purification ? Les sons l’hallucinaient, il se composait des polyphonies, entre deux communions du dimanche. Il était bien le seul, à cent lieues à la ronde.
Le pâté de sanglier communique une humeur bien robuste, on se sent plus près de Dieu quand on a bouffé du bon sanglier, le Dieu de Zachée semble n’avoir pas plus de consistance que celui de son lointain cousin. Ce cousin voit Dieu à huit heures précises, quand le soleil perce la verrière d’ogive, différemment suivant les saisons. Zachée, lui, sent son Dieu dans son oreille, ou dans son ventre.
Jean-Robert le Cousin nage dans le bonheur de sa sainteté naissante, mais Zachée s’ennuie : trop de chasses, trop d’amis, trop de repas. Fils de putes ! s’écria-t-il un jour qu’il avait bu (ces jours sont très rares) : débarrassez la table, et me débarrassez aussi. Je ne ferai plus de vieux os, la goutte m’entrave et je ne pisse plus ».
- Vous mangez trop de gibier, dit le serviteur.
- Vous servez trop de gibier, dit Zachée.
- Il semble que Monseigneur ne se soit pas déchargé depuis un fort long temps.
- Je frise l’apoplexie, Nestor, je dépasse quarante-six ans. C’est un miracle que mon ventre soir resté plat ». Le serviteur le trouva vulgaire ; Zachée verrait sa maîtresse tantôt. Elle était dans la pièce voisine, attendant le plaisir du sangliophage. Zachée grimace : « Je ne pourrai jamais styler ce porte-plat ». « Contre la mélancolie » poursuit le serviteur, « le Sieur de Boisy lui-même n’a pas trouvé de remède . - On ne dit pas « le Sieur de Boisy ».
Avec la bonne ecclésiastique, en service d’extra, ils le jetèrent sur un lit dela pièce voisine où la maîtresse en titre est venu sucer quelque gland vaguement baveux. Il ne pouvait plus s’agiter. Mais dès qu’il fut seul et ses mains torchées, il écrivit ce qui suit :
« Cher ami cousin Jean-Robert,
« Je suis le seul à pouvoir de traiter de ces titres. Curieuse destinée décidément pour nous autres, qui t’a mené à la tête d’un grand monastère, tandis que je me vautre à la ferme parmi les femmes et les dépendances.
« Nous avons fait la Petite École ensemble, mais tu es monté à Nancy – qu’est-ce qu’on se sera donné tous les deux sur le plateau, chasses et galopades ! Tu ne refusais pas le cheval – j’ai dû pour ma part y renoncer cette année : des douleurs atroces, pour moi et pour la bête en raison de mon poids, et tu chassais, je m’en souviens bien, plus que je ne priais.
« Puis nous allions basculer, non pas les belles au moulin comme nous le faisions croire, mais les sacs de farine dans le pétrin du boulanger.
« Tu as fait des pèlerinages pour voir du pays : Notre-Dame en Italie, tandis que je me charroyais de Marseille à Montpellier, où les gens comprennent mon patois latin. Je rapporte de la poussière et toi des bénédictions. À Béziers j’ai inventé les fréjolles de calmoutiers : des miettes de poisson, des cougourdes ; mêler à de l’ail, plus une piperade, un brin de lièvre, et c’est immangeable ». Plus tard : « Comment fais-tu pour vivre, ô cousin de ma première épouse ? sans manger ni dormir, ni presque boire à ce qu’on dit ? Dieu dans nos légumes, dans nos fruits ? je ne le trouve pas. Mon rêve est de me purifier de l’envie, par l’admiration, mais je me sens tout décapé de par dedans. Tu vois Dieu ? Cela doit te suffire. Toi, le Prieur, intercède ».
« Prie-le d’alléger mes sauces, de rendre à mon rébec son efficacité soignante. L’acédie, ou l’ennui, est péché capital. Et Dieu à tout instant, sous ta verrière, ce ne serait pas de la gourmandise ? ...Jusqu’à mon admiration, qui ne te manque pas ». Plus tard : « Ce qui signifie, cousin d’alliance, que ne demandant rien tu obtiens tout. Prends garde au péché d’excessive satisfaction, sans même savoir si tu le commets. À ta place je le commettrais. Pourtant tu ne dis jamais de quelles grâces tu profites. Les autres disent : « Sa renommée a volé jusqu’à nous ».
«Modeste et fier en même temps. « Dieu est silence », mais les mines que tu prends sont-elles du silence ? As-tu l’air extasié, ou absent, très froid ? Comment supportent-ils, en ton monastère de St-Clothy, que rien ne soit vraiment administré ? Ton second ; Ikselles, très vieux, n’a-t-il pas toute autorité en ton nom ? Il tremble de peur de mourir : n’est-ce pas une honte, venant d’un moine comme lui ? ...Tu pourrais voir Dieu dans une rivière, ou dans les poissons que tu pêcherais, comme il est dit dans la Genèse ? ...Tu t’élèves et parades au sommet de ta verrière, phénomène de foi. De foire. Si tu meurs, parlera-ton de « transfert en haut lieu » ? Seras-tu remplacé par une momie de cire blanche ? « Itinéraire d’un grand saint », « De la momerie à la momie »…
-
Le chemin parcouru
COLLIGNON LE CHEMIN PARCOURU
L'EFFONDREMENT DE ROSSENBERG
1) Nuit à Rossenberg
a) les lieux (trois pages)
1) le bâtiment et ses entours (une page)
2) chambre blanche, petit lit de camp, portrait d'Henri V de Chambord. (une page)
3) ma compagne à côté (une page)? et l'impression étrange des volets hermétiquement clos. (une page)
b) les raisons pour lesquelles nous y sommes, (trois pages) le froid ou le chaud selon les saisons,
c) élargissement de l'espace, sorte de vaste palombière aux ramifications immenses, cf. l'hôtel d'I. à l'horizontale.
DIX PAGES (EN FAIT, SIX SEULEMENT)
2) L'effondrement
a) alors que je me balade, effondrement d'une aile, je sais qu'il y a qq dessous, je décris les bâtiments, cf. une illustration de la collection "tremblements de terre et catastrophes naturelles"
b) les hommes vont sur le terrain (torchis, colombages), (laine de verre, masques) - moi, je suis méprisé, on ne me confie que le nettoyage de la vaisselle, aidé par des fillettes, puits à chadouf, bien préciser à ce moment la situation d'humiliation et d'infériorisation dont je suis l'objet dans ce groupe de merde.
c) Evocation effectivement d'O. qui me traite de Gugusse et de L. qui me remet le moteur en marche. Ne pas hésiter à dévoiler alors leur peu glorieux avenir (digeridoo, Uruguay)
3) Mes lectures, destinées à bien montrer combien je suis supérieur (Musset aux chiotttes à la caserne, chapitre sur Ulysse dans "Si c'est un homme", ceci avec l'une des fillettes. Mais, "après-midi vaseux".
a) mon bouquin, sa découverte dans les décombres, mon rafistolage, ce que je m'en promets
b) un commentaire là-dessus
c) ma transmission, très chaste, pendant la nuit à la petite fille, cf. Nuit de Mai, "Que c'est beau !"
4) Ma soûlographie en mémoire de l'ermite
a) le menu pantagruélique "Au Paléolithique", "Au Grand Béarnais" à Sarlat, les sauveteurs se restaurent
b) Je suis ridicule et hargneux, cf. le barak hongrois, les cinq litres de vin avec L.
c) Une agressivité sauvage, ma paranoïa n'ayant cessé de croître
5) Le voyage du retour
a) Le trajet à travers le Bocage, avec la petite fille dont nous ne savons pas tous les deux qui est le père ; petite route et cimetière de G., pélerinage ultra-lent car nous n'y reviendrons plus.
b) le peintre Manolo, les adieux à tous.
c) engueulade magistrale devant la petite fille pour savoir qui de nous deux est le père.
6) Il faut pourtant larguer la fillette chez sa mère
a) l'accueil plus que mitigé, cf. Machinchose à Kekpar.
b) accueil dégueulasse de la fillette, cf. fille de V. à Villaras, écoeurant.
c) elle nous annonce qu'elle va l'abandonner chez une autre copine
7) Achat de bouffe cours Dr Lambert
a) je médite ma vengeance en achetant des produits avariés
b) je me lamente sur ma vie ratée, en retraçant la vie antérieure de mon compagnon et de moi
c) le repas est dégueulasse, avec la radio qui hurle sur le jambon d'York
8) Toujours la soirée studieuse
a) Je reviens sur Musset
b) je fais le tour de tous mes bouquins
c) je fais effondrer à mon tour toute ma cabane
9) Coincé dans ma poche d'air, j'attends les sauveteurs.
a) je me sortirai de là, j'irai à St-Flour
b) je ne pourrai jamais, jamais vivre seul
c) j'entends la voix de mon compagnon qui demande qu'on arrête les recherches, on m'arrose de créosote avant de mettre le feu.
Pendant ce temps-là je creuse, pour m'évader, deux cents mètres plus loin.
JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE
I, 1, a (une page)
Il est sur une bosse un lieu nommé « Calvitie de Vénus », avec dans la clairière une maison de bois: trois étages haussés par-dessus les cimes, en tous points comparable aux maisons fermières de l’Ouest canadien (Calgary, Mouse Jaw) – où croissent à l’infini les beaux blés de printemps. Juste devant l’entrée règne une calvitie d’herbe sans trace de jardinage : le propriétaire, Stoffer Jyves, poussant de plus en plus, assis sur sa tondeuse, la machine à débroussailler, a dégagé le sous-bois, découragé le feu.
Sec et décharné, le tondeur utilitaire et monotone poursuit à travers les âges son apocalypse - remise en fin de journée son engin sous son appentis. Sa femme Jamie au contraire entraîne dans son cercle tous ceux qui l’approchent, dans un sourire où s’évanouit toute disgrâce, accueillante aux visiteurs sans issue.
L'extérieur consiste en ces ingénieux recouvrements de lattes goudronnées plus enchevronnées vers les vent du nord-ouest : volants de Gitane biblique figée grise et verticale, pâtisserie de bois badigeonnée d’enduits dont l’entêtant parfum bitumineux redouble à chaque réfection. De rares ouvertures s’étagent sous leurs auvents, prolongées jusqu'au sol par ces raides volées de marches métalliques imposées par la législation contre l’incendie.
L'intérieur présente aussi ses raides échelles de meunier, trappes et rampes vernies, où se déclinent les couleurs de miel : il fait toujours bien chaud dans les étages.
I, a, 2
Le couple cependant évite les visites, les "intrusions". Jeanne et moi bénéficions seuls de leur hospitalité ; ils nous logent alors dans une chambre du rez-de-chaussée, à gauche, donnant de plain-pied sur la pelouse. Il y règne un froid glacial, à moins que nous n'y transportions un de ces chauffages d'appoint, aux résistances électriques rougeoyantes, à l'odeur entêtante : rien qui s'épuise plus vite que ces minuscules bouteilles de gaz compact, riches d'explosions absolument impossibles. Nous dormons dans un petit lit de fer luthérien qui grince lorsque nous y sautons, pour nous rejoindre et nous réfugier sous l'édredon. Les deux panneaux du lit, à la tête et au pied, présentent des ferronneries industrielles remarquablement conçues ; il n'y manque pas une volute, apparenté sans doute au mot volupté : le creux du matelas forme une étroite gouttière, et nulle nuit ne me revient en mémoire sans que je ne l'associe à d'intenses courbatures érotiques dues à l'emmêlement obligé des membres, tant supérieurs qu'inférieurs.
Mais nous aimons bien notre lit, qui fleure bon le puritanisme et ses douilletteries. Ce n'est cependant pas un crucifix qui le domine, mais un portrait de Napoléon par David, avec tout ce qu'on peut imaginer de plâtreux, ce profil gauche empâté, au menton engagé dans la graisse, majestueux mais déjà déchéant, le jaune cru, "gros jaune", et les écaillures lézardant l'esquisse. Rien d'officiel. Que du cruel, malgré le projet de "portrait équestre". Dormir sous le portrait de Napoléon deviendrait obsédant, si nous ne nous endormions tout de suite elle et moi, sous son poids justement.
Nos nuits sont encombrées de lourdeurs impériales propices aux infarctus. Le matin, lorsque sont enlevées les lourdes barres de fer qui closent le volet, nos regards se posent sur une affiche décharnée, occupant cette fois le verso de la porte : un horrible Christ aux Souffrances, chantourné par la douleur, ce qui veut dire creusé du dedans. Sur sa peau friable coulent des larmes de sang, comme autant de rubis malsains. Les couleurs sont donc : jaune impérial, rouge christique, gris d'agonie, et nous.
Puis la clairière, dégagée juste sous nos fenêtres, dont il nous suffirait d'enjamber les bords pour fouler l'herbe des Rocheuses. Les volets de bois lourd résonnent en s'ouvrant sur les bardeaux superposés, comme autant de volants d'une lourde gitane noire et goudronnée, figée dans une verticalité digne d'Edith, femme de Loth : une figure de bitume.
L'odeur stagne. Celle d'un bateau calfaté poupe en terre, comme un bloc de goudron fissuré.
1 a 3 Ma compagne
La femme qui est dans mon lit devrait être un homme. Un maigre à moustache, qu'il ne peut ni couper ni tailler. C'est bien plus facile de se faire enculer : comme une femme, rien à foutre et se laisser faire. On sait qu'on jouira plus tard, toute seule, tranquille, à la branlette. En attendant que le mec ait fini de se secouer comme un porc, on se sent utile, on sait où l'on va. Pourquoi n'ai-je jamais été de force à concevoir ce que c'est qu'une femme ? La mienne a des besoins tellement plus énormes que moi, tant en sexe qu'en sommeil, que je puis aussi bien me promener dans les sentiers de prairie pendant plus d'une heure, dans la rosée, avant qu'elle ait songé à s'éveiller.
La femme qui est dans mon lit est une femme. Elle ne dort, en vérité, jamais vraiment : du sein de sa torpeur et quelles que soit les questions que je lui pose, elle sera capable d'émettre un soupir ou une opinion pertinente. Je ne sens plus son odeur. Nous emmêlons nos membres au petit matin, au début de notre liaison je m'étouffais sous le poids de ses jambes, puis j'en ai redemandé, ce jour-là j'ai compris à quel point nous formions un vieux couple comme on dit d'un cheval de retour.
Je me suis plaint d'elle, c'était mon sujet de conversation : preuve d'amour, de même qu'un blasphème prouve l'existence de Dieu. Il n'y a pas de crucifix dans la chambre, mais tout un rite matinal est respecté, petits baisers sur la bouche et les yeux, frôlements de joue, expirations tendres, ma barbe grattant encore à peine, car je me suis rasé la veille au soir.
Nous n'y avons jamais froid dans le lit ni la pièce malgré les - 25 au dehors, il y règne toujours une transpiration, une buée de la lèvre supérieure de ma compagne délicieusement semblable à un loir au corps grassouillet, et Dieu me préserve de trouver un jour emmêlé à mes jambes les raides tibias d'un mâle moustachu plus rassurant mais sec. Je me suis toujours demandé comment la femme peut porter le corps de l'homme, à voir combien nous sommes démunis, taillés comme des bœufs, bâtis en barre à mine ou mous comme des poires avec des érections défaillantes - elles me disent, les femmes, du moins la seule que je connaisse et qui les a remplacées toutes, "vous êtes attendrissants", "nous vous portons dans notre ventre", ceci bien que l'une d'entre elles ait osé proférer (je l'ai lu) qu'elle refusait d'être enceinte d'un garçon pour ne pas avoir un sexe mâle dans le ventre, mon Dieu...
Puis nous passons au petit déjeuner, et là, d'un coup, c'est le silence : les corps ne se touchent plus. Ni mots, ni caresses, juste l'air abruti de qui a trop dormi, au-dessus d'un bol chaud. XXX 62 02 02 SV 92 XXX
ICI SINGE VERT N° 107
b) les raisons pour lesquelles nous y sommes, (trois pages) le froid ou le chaud selon les saisons, et
1) ceux qui nous hébergent,
2)nous leur devons de l'argent et des services, voilà pourquoi nous sommes là, tous les ans depuis des années,
3)je n'ai jamais pu déterminer si mon mec (je ne suis pas homosexuel, nous nous débrouillons chacun de notre côté) couche ou non avec le mâle, cf. aussi le bossu d'Issigeac et cet hôtel abandonné.
I, b, 1) ceux qui nous hébergent.
Soixante-dix, quatre-vingts fois, nous aurons débouché dans cette salle sentant la cendre été comme hiver, frissonnant le matin sous nos peignoirs troués, retrouvant sur la table invariablement les toasts saisis à point, ou ramenant sur nous les pans inusités de nos habits de vie, car nous couchons nus et ne nous rajustons que pour la décence. L'été, la porte intérieure s'entr'ouvre, et déjà nos hôtes sont là, souriants, prévisibles, humains. Comme nous sortons de nos tendresses personnelles, cet accueil agissait jadis comme un viol : d'autres êtres que nous peuvent donc s'aimer aussi bien que nous, avec leurs secrets à confier ou taire.
L'hôte, grand maigre taciturne, ouvre et ferme ses longues mâchoires. Il mange salement, avec des claquements. Je voudrais voir les pluvians nilotiques picorer ses interstices interdentaires. Je hais ces gens et leur suis attaché si viscéralement que je ne sais pas ce que je pense. La boulette de graisse qui lui sert de femme tourbillonne autour de nous en imitant, à la lettre, la chouette: c’est-à-dire non pas ce doux hululement du hibou,mais cette criaillerie obscène du nocturne dépeçant sa proie. Depuis, à mon compagnon comme à moi, il n’est croissant si chaud ni si moelleux qui ne nous rappelle le goût du rongeur mort.
Parfois lui et moi partons dans ces bois, à nuit tombante, fusils cassés à la main, bien que cela soit strictement interdit par les autorités de Regina ou Saskatoon : tout est loin. Nous feignons d'imiter le hibou qui bouboule ; il nous est répondu par familles entières sous le long ciel arctique de septembre. Et en vérité combien nous sommes désappointés, même atteints d’une sombre colère, de ne point voir sur la silhouette des branches à peine distinctes à présent ne fût-ce qu’une ombre géante et tutélaire de rapace. Nous rentrons seuls, la mort délicieuse dans l’âme ; en vue de la haute tour hantée par le vieux couple (réflexe guerrier, comme une porte qu’on pousse à regret), nous refermons d’un déclic sec nos deux fusils.
Décidément, celui avec lequel je dors est un homme. Mais nous ne nous touchons pas de la nuit. Il est des obscénités qu’on ne commet pas entre hommes. Casqués et bottés. Ce lit de fer, c’est une tranchée. Il y a eu beaucoup de viols entre hommes et de tentatives dans les tranchées d'Europe. Nos fusils devant nous sur le râtelier, vue sur nos virilités au clou, nous sentons s'appesantir nos paupières, et nous sombrons dans le plomb jusqu’au petit matin. J’ouvre le volet qui bat lourdement la paroi, je sens monter d’en bas les effluves d’une chicorée amère, déjà la chouette féminine nous informe que le petit-déjeuner est prêt, ajoutant quelques crouacs qu’elle croit de très bon augure. Alors éclatent entre les deux hommes que nous sommes, renfilant sans nous laver nos habits pour la décence, des scènes de ménage entre les dents.
Nous leur devons de l'argent, des services. Voilà pourquoi nous sommes là, tous les ans depuis des années. Nous venons d’Edmonton, 326 miles. C’est sans originalité. Nous ne devrions pas appeler réellement cette ville « Edmonton », car « Edmonton » existe réellement. Disons que la nôtre est perdue au milieu d’un désert glacé, soudain truffé de hauts gratte-ciel où il ne viendrait à personne l’idée de précipiter un avion, avec des silos à grains d’une hauteur démesurée, où tout fermente sous la paupière obtuse des thermostats lumineux. Mais tous les étés, tous les automnes, tous les hivers aussi (les scooters des neiges déblaient tout) nous ramènent chez Jywes et Holly, son épouse.
Nous leur devons cela. Ils ont acheté pour nous cette haute baraque, « la Masure », alors que rien, strictement rien ne les y obligeait. Mais comme ils ont bien vu que rien ni personne ne nous ferait mettre « la main à la pâte », que décidément nous n’étions pas dignes de ce somptueux cadeau, ne sachant ni bricoler quoi que ce fût ni passer une couche de lasure tant soit peu régulière ni quelque fongicide que ce soit, ils se sont sentis obligés d’occuper notre maison, de l’entretenir, d’y passer couche de pinceau sur couche de pinceau, goudron sur goudron, de clouer bardeau sur bardeau. Ils avaient eux aussi leur petite maison bien cernée de pelouse, en banlieue, ils partaient à la pêche au Lac des Esclaves, la température descendait à des degrés inimaginables - mais ici, à la Masure, c’étaient eux qui entretenaient cette maison qu’ils nous avaient offerte.
Est-ce qu’il ne s’était pas agi à un moment donné de Dieu savait quel billet de loto gagnant que nous aurions partagé, est-ce que nous ne nous serions pas bien mieux entendus jadis qu’à présent, est-ce que nous n’avions pas échangé nos femmes ou nos maris, n’y avait-il pas entre nous de ces secrets qui traînent depuis des décennies à l’intérieur des sectes et des communautés qui se sont faites, toutes, ne vous y trompez pas, à l’époque des Guerres du Viet-Nam ? canadiens ou pas... Ceux qui sont passés par ces épisodes confus peuvent seuls savoir - et nous sommes loin d’être justement les seuls - le caractère irréfragable que peuvent prendre alors les liens qui se tissent entre les gens, le fait d’avoir senti subrepticement se glisser en vous une queue qui ne vous était pas destinée, qu’on soit mâle ou femelle - ceux-là seuls peuvent comprendre l’impossibilité archi-absolue de toute rupture, le silence qui s’abat sur vous pendant des années, les folies aux visages variés qui vous font ou pousser des cris de chouettes ou des bubulements de hiboux, les culpabilités molles, les traînassements d’habitudes, et les jouissances de désespoir, de dérisions, lorsque le vent qui se faufile entre les cimes vient se heurter à nos volets.
Ici les nuits comptent plus que les jours, elles ont une épaisseur révélatrice, elles vous révèlent incomparablement plus que les jours ce que c’est que le Pays de Moose Jaw, de Poughkeepsie, de tous ces lieux imaginaires auxquels il est formellement interdit de donner des noms vrais : une épaisseur qui vous plombe aussitôt dans un sommeil où l’on ne sait pas ce qui rampe entre vos jambes si c’est une femme (une lourde cuisse grasse) ou ce qui reste obstinément raidi sous le tissu sale et roide d’un pantalon insensible et désastreusement immobile, lorsqu’il s’agit d’un homme. Ce qui précède en sv 107 XXX 63 07 03
1 b) 3 3)je n'ai jamais pu déterminer si mon mec (je ne suis pas homosexuel, nous nous débrouillons chacun de notre côté) couche ou non avec le mâle, cf. aussi le bossu d'Issigeac et cet hôtel abandonné.
De notre chambre à coucher fermée par des barrières à la salle du petit-déjeuner, il n’y a qu’une échelle-de-meunier, ce genre d’escalier qui provoque lamort de tant de bambins qu’on doit clore le haut par une petite barrière dont seuls les adultes possèdent la clé. Mais nous explorons les étages supérieurs. C’est comme dans un rêve. Nous ne nous sommes pas déshabillés, nous portons nos fusils cassés le long de notre hanche, nous montons les yeux fixes dans le noir, où nous acquérons la vue puissante et nyctalope des oiseaux que nous trouvons pas. Ce sont des chambres vides, à l’infini, en hauteur, comme si en vérité le bâtiment se rehaussait à mesure que nous le parcourions, comme s’il s’érigeait, à mesure que nous découvrions les chambres abandonnées, lavabos orphelins gouttant dans la nuit, draps roulés et défaits, les matelas mêlants leurs rayures ; ampoules mouchetées chiures, blafardes et grésillantes, bien plus propres à effrayer qu’à éclairer, tandis que s’ébranlent dans notre dos, plus effrayants que s’ils étaient là tout proches à nous toucher, des lourds usufruitiers qui nous demandent ce que nous pouvons bien foutre là-haut, à gaspiller de l’électricité, à voir quoi, bon Dieu, à moins qu’ils ne nous pressent de les payer enfin en travaux d’entretien auxquels nous ne condescendrons jamais.
Nous savons qu’ils entrent avec nous, dans la chasse aux escaliers, cette créature qu’ils relâchent la nuit et hante les bas-fonds de leur cave, non point Ligéia ici enterrée vive, mais ce bossu par-devant, bossu par-derrière, bitord, qu'ils ont ramené de banlieue - cet homme, Vercassis, exerce la profession de modèle; il teint son nez et ses pommettes en vermillon. Il se fait photographier dans les postures les plus difformes. Puis il est revendu sous forme de figurines. Se faire poursuivre de nuit par lui dans les étages nous flanque à tous les deux mon chasseur et moi, des terreurs atroces ; et quand dans notre épuisement sur nos talons parfois son nez passe la spirale, nous explosons le pas et l'étage s'ajoute aux étages.
Que va-t-il advenir de nous ? Mon chasseur et moi ne savons planter un clou. C’est tout le bâtiment de bois qui s’ébranle ainsi au milieu de la nuit. Nous savons qu’après la mort de nos protecteurs ce bâtiment restera quelque temps plus ou moins entretenu, puis qu’il s’affaissera sur nous sous ses poutres et nos sciures. Nous reviendrons à Edmonton au printemps. Nous y suivrons des cours de charpente. Nous rétablirons le courant pour que les lampes sans abat-jour cessent enfin de tressauter comme des paupières.
c) élargissement de l'espace, sorte de vaste palombière aux ramifications immenses, cf. l'hôtel d'Issigeac à l'horizontale.
Cette partie est devenue inutile, car tout a déjà été développé dans les paragraphes précédents, avec force détails.
2) L'effondrement
1° alors que je me balade, effondrement d'une aile,
2° une illustration de la collection "tremblements de terre et catastrophes naturelles"
3° je sais qu'il y a qq dessous, je décris les bâtiments,
I, 2, a : une page
X
Deux chemins partent de la clairière où Jywes traîne incessamment sa silhouette chevaline sur sa tondeuse ; deux sentiers raides dévalent raidement de part et d’autre de la haute calvitie que couronne la tour. Il faut avec entêtement lutter contre la descente avec autant d’obstination qu’on l'a gravie, tant les buissons, les ronces, les végétaux piquants vous agrippent au passage, vous protègent de la chute ; c’est le chemin du sud qui vous retient le plus. Celui du Nord plus doux mène au Lac Travey ; il caresse d’abord l’épaule par de hautes fougères arborescentes. Il se dégage alors de ces petits champignons éclatants (lorsqu’on les foule) un parfum pénétrant de spores, éjaculation végétale, poussière balsamique.
Et je les parcourais, alternativement, déplorant le peu d’espace offert par ces bois ancestraux, tandis que mon compagnon le chasseur gisait vivant tout raide auprès de son fusil. Je songeais à cette arme entre nos corps placée. C’était la pente sud ou femelle, et mes nombreux passages à pied dans ses broussailles rendaient chaque fois moins piquants mes agrippements, lorsqu’il me sembla ouïr un craquement sourd et lointain ; la terre ondula sous mes pieds, des éboulements se distinguèrent au sein des fourrés. Remontant la pente avec essoufflement, parfois m'accrochant des deux mains à terre, je pressentis que le Bouclier Hercynien Canadien, qui se pensait à l’abri des séismes, subissait une secousse bien réelle.
Tout le monde a déjà ressenti un séisme : sensation de nausée, perte d’équilibre et de tout repère, angoissante question de sa propre existence (un point, une poussière) : il y a dans cet abandon une douceur infinie, des endormissements. Je voulus courir vers la cabane, dont plusieurs tournants montants me séparaient au plus épais des fourrés. Les arbres autour de moi craquaient sans s'abattre ; ils fourniraient le bois de mon cercueil, car ils m'enseveliraient dans leur chute imminente. Il existe ici de ces espèces balsamiques remontant à des millénaires. Peut-être des gisements de houille hantent-ils le sol où je me débats, mais qui planterait des chevalets d’extraction parmi les bavures de lianes argentées ? Je remontais péniblement la pente. Pourtant c’était comme un jeu. Le creux de mes mains s'écorchait. Les branches basses m’entraînaient dans une valse infernale et facétieuse.
Puis le sol recouvrait sa stabilité. Je courais sur les aiguilles de conifères, bien rangées, bien sèches. Puis tout se remettait à onduler comme la peau d’un serpent dans les parfums, de nouveaux tournants se précisaient entre les buissons bas. Acte d'amour terrifiant et merveilleux avec Nature, à la fois dangereux et affectueux, car elle est capable de délicatesses. Je ne risquais rien, à moine que le démon n’ouvrît sous moi une de ces crevasses d’engloutissement, aussi facilement refermées qu’ouvertes.
2° une illustration de la collection "tremblements de terre et catastrophes naturelles"
Une page
Le bâtiment, quand je le vis enfin, m’offrit l’image d’une invraisemblance absolue. Comment avait-il pu se faire qu’une surface aussi réduite n’eût pas provoqué un effondrement « en château de cartes » ? Les convulsions du chat ou de la tortue (disent les Japonais) sur lesquels nous vivons, vermine humaine, sont imprévisibles : une partie du bâtiment restait intacte ; c’était la moitié sud-est. Les volants étagés du bois, en jupe géante, restaient fixés l’un sur l’autre comme un grand pan d'écailles. Et d'un coup, au-delà d’une flèche de bois que la secousse avait propulsée à la verticale, toute l'habitation de Mont Shaïle s’était affalée au nord-ouest, en direction de l’Alaska. C’était comme un épine dorsale brisée, un long chevauchement de chevalets d’échine, un espadon mille fois rompu et rerompu, un léviathan fossile mal classé encore par les paléontologues, comme si le tremblement de terre s’était produit vingt millions d’années avant notre ère, et que les morceaux d’un ichthyosaure - les mots m’échappent, comme la terre sous mes pieds. La sciure planait par-dessus tout cela. L’odeur était merveilleuse, les particules demeuraient suspendues à deux mètre ou trois au-dessus du sol, et répandaient cette saveur de bois qui détermine les vocations de forestiers for ever, quel que soit le bas salaire qu’on obtienne dans ces professions déshéritées, loin de tout.
Un journaliste pressé -j’aurais pu vendre très cher mon reportage, mes clichés si j’avais eu l’esprit de porter sur moi un Nikon 400 E - « Je devrais me barder d’appareils photographiques, ces deux sentiers sont si riches que je rapporterais au poins de quoi garnir deux albums » - et puis j’oubliais - aurait alors mitraillé cette scierie bombardée,ce chaos d’éclatures où subsistait le grand dessein d’un architecte. Nulle fumée ne s’élevait encore, à l’exception de cette écharpe odorante et blonde, et c’était merveilleux, en vérité, que nul incendie ne se fût déclaré, ni ne menaçât, car mon odorat était aux aguets. Tous les sens jouissaient e la perspective eshétique offerte à moi. Les oreilles jouissaient d’une sorte d’écho : de là où j’étais, les arbres bienveillants m’avaient masqu » le bruit de l’effondrement, qui avait dû se produire très lentement, comme un froissement de vent dans les feuilles. Je me penchai pour cueillir au bout de mes doigts de cette matière merveilleuse, et je pensais qu’ainsi s’effondrent les empires, il n’en reste plus que le parfum qui pour toujours entête les civilisation à venir.
Des champignons, des insectes, se repaîtraient de cette sciure. J’étais subjuguée, transformé en femme, ouverte à toutes les sensations. Enfin, pensais-je, notre prison n’existe plus. Je ne pensais pas : « Comment vais-je réapprendre à vivre désormais ? » Non, la destruction, préalable à toute renaissance, m’apparaissait dans toute sa bienfaisance. Je longeais ces « poutrelles désaxées », ces planchers désormais verticaux, j’évaluais en connaisseuse ‘désormais j’étais femme, pour un certain temps, je priais l’intérieur de moi-même pour que cet état divin se prolongeât, car la femme est proche du divin autant que le sommet s’affale à terre et en épouse les contours) l’angle, techniquement parlant, 25° ? 45 ° ? où tous ces enchevêtrements se présentaient.
Et rien, Dieu merci, n’était reconnaissable, ni la chambre, où trônaient les hideuses images, ni la chambre des deux monstres, l’homme et la femme encore condamnés à leur sexe respectif, seule peut-être la tondeuse à gazon osait montrer son large siège de cuir en forme de cul : je voyais les deux étroites ellipses dessinant sur le cuir la marque des fesses d’un certain Jywes.
3° je sais qu'il y a qq dessous, je décris les bâtiments, une page
Alors seulement j’acceptai de penser aux humains. Qui était vivant, qui était mort ? Le cheval maudit, l’homme à la tondeuse ? Notre hôtesse, la graisseuse, toujours à virevolter au milieu de ses tartines ? Mon compagnon le chasseur, sale et raide dans ses pantalons militaires, et qui ne me touchait jamais pendant la nuit ? Je ne l’aurais pas suporté : qu’il se lavât, d’abord. C’était vraiment, j’y revenais toujours, l’odeur qui m’emplissait tout entière, du poumon à ces cavités que je sentais, nouvelles et palpitantes, désormais vivre en moi - mais pour combien de temps ? Mon Dieu, faites que mon changement de sexe se confirme ! La sciure me pénètre par tous les pores. A la moindre odeurde cadavre, d’ici quarante-huit heures je suppose au plus tard, je sens que je redeviendrais un homme.
En même temps, quelque chose s’agitait dans mon esprit : « Tu n’es pas raisonnable. Tu es monstrueuse. Tu jouis du spectacle, tu palpes le bois frais, sans t’inquiéter de ceux qui vivaient là, qui se préparaient à vivre une de ces merveilleuses matinées solitaires. Tu aimerais, n’est-il pas vrai, qu’ils revécussent, qu’ils revinssent à la vie, afin de reprendre cette histoire qui ne t’avait jamais appartenu...
Tout est trop calme. Il ne règne absolument pas d’atmosphère de mort. Une heureuse coïncidence a fait que tous auront survécu. Je me fais peur. Il n’y a pas de mal. Ils sortiront de leur cage de bois, soit de la partie miraculeusement restée intacte, soit de cette longue avancée disloquée. Et c’est d’abord le cheval funèbre, le chevaucheur de tondeuse à gazon, qui s’ébroue de sa sciure, tout près de la base, où le poids a pesé le moins. Il me regarde hébété, les bras ballants. Il ne trouve rien à me dire, ses lèvres sont retroussées exactement comme celles d’un cheval sur le mort, je vois ses dents jaunes dont je détourne toujoiurs le regard pendant les petits-déjeuners si copieux.
A mon grand désespoir, à mon grand soulagement - comment définir ces deux choses, là, juxaposées ? - je vois la boulette sortant par la demi-porte restante, car la catastrophe l’a surprise au milieu des étages. Elle était en train de manger, les lèvres lui dégoulinent encore de sirop d’érable. Pourquoi les tremblements de terre n’éliminent-ils jamais ceux envers lesquels nous sommes redevables ? Pourquoi me trouvais-je si proche, dans un chemin creux, encombré de buissons ? Où est mon chasseur ? Il étire son long cou de l’autre côté du bâtiment, il revient lui aussi de promenade, il a pris le second sentier, vers le nord, il ramène par les ouïes une carpe à demi morte, que l’affolement a jetée sur sa ligne,
TEXTE DU CHEMIN PARCOURU
COLLIGNON LE CHEMIN PARCOURU
L'EFFONDREMENT DE ROSSENBERG TEXTES
1) Nuit à Rossenberg
a) les lieux (trois pages)
1) le bâtiment et ses entours (une page)
2) la chambre blanche, le petit lit de fer, le portrait de Henri V comte de Chambord. (une page)
3) ma compagne à côté (une page)
b) les raisons pour lesquelles nous y sommes, (trois pages) le froid ou le chaud selon les saisons,
c) élargissement de l'espace, sorte de vaste palombière aux ramifications immenses, cf. l'hôtel d'I. à l'horizontale.
DIX PAGES (EN FAIT, SIX SEULEMENT)
2) L'effondrement
a) alors que je me balade, effondrement d'une aile, je sais qu'il y a qq dessous, je décris les bâtiments, cf. une illustration de la collection "tremblements de terre et catastrophes naturelles"
b) les hommes vont sur le terrain (torchis, colombages), (laine de verre, masques) - moi, je suis méprisé, on ne me confie que le nettoyage de la vaisselle, aidé par des fillettes, puits à chadouf, bien préciser à ce moment la situation d'humiliation et d'infériorisation dont je suis l'objet dans ce groupe de merde.
c) Evocation effectivement d'O. qui me traite de Gugusse et de L. qui me remet le moteur en marche. Ne pas hésiter à dévoiler alors leur peu glorieux avenir (digeridoo, Uruguay)
3) Mes lectures, destinées à bien montrer combien je suis supérieur (Musset aux chiotttes à la caserne, chapitre sur Ulysse dans "Si c'est un homme", ceci avec l'une des fillettes. Mais, "après-midi vaseux".
a) mon bouquin, sa découverte dans les décombres, mon rafistolage, ce que je m'en promets
b) un commentaire là-dessus
c) ma transmission, très chaste, pendant la nuit à la petite fille, cf. Nuit de Mai, "Que c'est beau !"
4) Ma soûlographie en mémoire de l'ermite
a) le menu pantagruélique "Aux chasseurs", "A l'auberge basque" à Sarlat, les sauveteurs se restaurent, O.K.
b) Je suis ridicule et hargneux, cf. le barak hongrois, les cinq litres de vin avec L.
c) Une agressivité sauvage, ma paranoïa n'ayant cessé de monter.
5) Le voyage du retour
a) Le trajet à travers le Bocage, avec la petite fille dont nous ne savons pas tous les deux qui est le père ; petite route et cimetière de G., pélerinage ultra-lent car nous n'y reviendrons plus.
b) le peintre Manolo, les adieux à tous.
c) engueulade magistrale devant la petite fille pour savoir qui de nous deux est le père.
6) Il faut pourtant larguer la fillette chez sa mère
a) l'accueil plus que mitigé, cf. Machinchose à Kekpar.
b) accueil dégueulasse de la fillette, cf. fille de V. à Villaras, écoeurant.
c) elle nous annonce qu'elle va la larguer chez une autre copine
7) Achat de bouffe cours Dr Lambert
a) je médite ma vengeance en achetant des produits avariés
b) je me lamente sur ma vie ratée, en retraçant la vie antérieure de mon compagnon et de moi
c) le repas est dégueulasse, avec la radio qui hurle sur le jambon d'York
8) Toujours la soirée studieuse
a) Je reviens sur Musset
b) je fais le tour de tous mes bouquins
c) je fais effondrer à mon tour toute ma cabane
9) Coincé dans ma poche d'air, j'attends les sauveteurs.
a) je me sortirai de là, j'irai à St-Flour
b) je ne pourrai jamais, jamais vivre seul
c) j'entends la voix de mon compagnon qui demande qu'on arrête les recherches, on m'arrose de créosote avant de mettre le feu.
Pendant ce temps-là je creuse, pour m'évader, deux cents mètres plus loin.
XXX61 04 23XXX
rossenberg 3
I) Nuit à ROSSENBERG
a) lieux
1) le bâtiment et ses entours (une page)
2) la chambre blanche, le petit lit de fer, le portrait de Henri V comte de Chambord. (une page)
3) ma compagne à côté, et l'impression étrange des volets hermétiquement clos. (une page)
I, 1, a (une page)
Il est au sommet d'une montagne un lieu étrange et pénétrant, nommé la Calvie de Vénus, où se dresse un des plus étranges chalets. C'est au centre d'une clairière une haute maison de bois, correspond pourtant aux normes architecturales de ces contrées : trois étages dont le dernier jette juste un coup d'oeil par-dessus les cimes, et semble un fenil aménagé. Comparable en tous points à ces hautes maisons de fermiers, dans l'Ouest canadien (près de Calgary, ou de Mouse Jaw) - là où s'étendent de si vastes arpents de blé de printemps.
Pourtant il ne règne au rez-de-chaussée qu'un rond de prairie, comme une calvitie de verge (d'où le nom "Calvi[ti]e de Vénus"), sans aucune culture ni trace d'aucune sorte de jardinage. Le propriétaire du lieu, Stoffer Jywes, passe de plus en plus loin sa tondeuse à gazon, sur laquelle il s'asseoit, et pousse entre les arbres des débroussaillages de plus en plus lointains, si bien que les sous-bois du sommet du Mont Chauve se trouvent parfaitement dégagés, bien propres à décourager les incendies.
Sec et décharné sur sa tondeuse, il semble en vérité quelque cavalier dégénéré de l'Apocalypse de Dürer, motorisé, utilitaire et monotone. Il la remise sous un appentis, en lisière des hauts feuillus qui délimitent sa clairière. Sa femme est tout le contraire : une joyeuse boule de graisse, dont le sourire efface la disgrâce, et qui accueille le mieux possible les visiteurs, à l'endroit où parvient la route tortueuse et sans issue menant à cet ermitage conjugal.
L'extérieur du bâtiment consiste en un savant assemblage, tout simple en réalité, commun encore en ces régions, de lattes goudronnées se recouvrant l'une l'autre, mieux ajustées encore vers le Nord-Ouest. Le tout, recouvert de divers enduits, présente l'aspect d'un gâteau de bois indigeste et revêche, aux rares ouvertures disposées sous les auvents, toutes munies de raides escaliers externes imposés par la législation anti-incendies.
L'intérieur retrace l'histoire d'une lutte contre la verticalité : ce ne sont qu'échelles de meunier, trappes périlleuses et rampes vernies, où règnent cependant des teintes blond clair, presque miel : il fait toujours bien chaud passé le premier étage. xxx61 05 04 XXX
rossenberg 4
I, a, 2
la chambre blanche et son décor (le petit lit de fer, le portrait de Henri V comte de Chambord). (cf. aussi l'affiche de Saratov)
Les deux êtres décrits plus hauts détestent autant qu'il se peut les visites, qu'ils appellent "intrusions". Ma femme Jeanne et moi bénéficions seuls de leur hospitalité ; ils nous logent alors dans une chambre du rez-de-chaussée, à gauche, donnant de plain-pied sur la pelouse. Il y règne un froid glacial, à moins que nous n'y transportions un de ces chauffages d'appoint, aux résistances rougeoyantes, à l'odeur entêtante : rien qui s'épuise plus vite que ces minuscules bouteilles de gaz compact, riches sans doute en émanations de Co².
Nous dormons dans un petit lit de fer protestant, qui grince allègrement lorsque nous y sautons, pour nous abriter sous l'épais édredon. Les deux panneaux du lit présentent des ferronneries courantes à la fois et remarquablement exécutées, il n'y manque pas une volute, ce mot rappelle "volupté", ce que nous nous efforçons d'atteindre, souvent avec succès : le centre du matelas forme une étroite gouttière, et nulle nuit ne me revient en mémoire sans que je ne l'associe à d'intenses courbatures dues à l'emmêlement obligé des membres, tant supérieurs qu'inférieurs.
Mais nous aimons bien notre lit, qui fleure bon le faux puritanisme et ses ferreuses douilletteries conjugales. Ce n'est cependant pas un crucifix qui le domine, mais un portrait de Napoléon, Neumeier, Nicolas Ier ou II, le Maréchal Ney... en rapport avec une commémoration). Je crois qu'il s'agit fort banalement d'un portrait de Napoléon par David, avec tout ce qu'on peut d'imaginer de plâtreux, ce profil gauche empâté, au menton engagé dans la graisse, majestueux mais déjà déchéant, le jaune cru, "gros jaune", et les écaillures déjà lézardant l'esquisse. Rien d'officiel. Que du cruel, malgré le projet de "portrait équestre". Dormir sous le portrait de Napoléon devientdrait obsédant, si nous ne nous endormions tout de suite elle et moi, par son poids justement.
Nos nuits sont encombrées de lourdeurs impériales, de jaunes d'oeufs mal digérés, propices aux infarctus. Le matin, lorsque sont enlevées les lourdes barres de fer qui closent le volet, nos regards se posent sur une affiche décharnée, occupant le verso de la porte : un horrible Christ aux Souffrances, le visage chantourné par la douleur, ce qui veut dire creusé de l'intérieur. Sur sa peau friable coulent de voluptueuses larmes de sang, comem autant de rubis malsains. Les couleurs sont donc : jaune impérial, rouge christique, gris poreux d'une chair d'agonie, et nous.
Puis la clairière, qui se dégage à un mètre sous nos fenêtres mêmes, qu'il nous suffirait d'enjamber pour fouler toutes ces herbes des Rocheuses du Nord... Les volets de bois lourd résonnent en se rabattant sur les bardeaux superposés comme autant de volants d'une lourde, noire, goudronnée, improbable gitane, qui danserait sur place, dans une verticalité aussi figée que celle de la femme de Loth : une statue de bitume.
L'odeur est là. La maison est un effroyable bateau fiché poupe en terre, comme un bloc de goudron fissuré. XXX61 05 04XXX
1 a 3 Ma compagne
Cette femme qui est dans mon lit est un homme. Je le vois comme un mâle maigre, affublé d'une moustache qu'il ne veut jamais couper ni tailler. Il est beaucoup plus facile de se faire enculer. On se sent utile, on sait où l'on va. Pourquoi n'ai-je jamais été de force à concevoir ce que c'est qu'une femme ? Elle a des besoins tellement plus énormes que moi en sommeil que je puis aussi bien me promener dans les sentiers alentour une heure,batifolant dans la rosée, avant qu'elle ait ouvert l'oeil. La femme qui est dans mon lit est une femme. Je ne parviens pas à me décider. Elle ne dort jamais. Au sein du plus profond sommeil et quelle que soit la question que je pose, elle sera capable d'émettre une opinion ou un soupir, tout cela très pertinent. Nous nous connaissons depuis si longtemps qu'elle change de sexe à volonté de mes fantasmes. Je ne sens plus son odeur. Nous emmêlons nos membres au petit matin, au début de notr eliaison je m'étouffais sous le pids de ses jambes, puis j'en ai redemandé, ce jour-là j'ai compris à quel point nous formions un vieux couple de vieux chevaux. De retour.
Je me suis plaint d'elle, car c'est mon principal sujet de conversation : dire du mal de sa femme est la preuve même de son amour, de même que le blasphème est preuve de l'existence de Dieu. Il n'y a pas de crucifix dans la chambre, mais mon Dieu il faut toujours que tout un rite soit respecté, de petits baisers sur la bouche et les yeux, de frôlements de joue, de soupirs tendres, et c'est malgré la misogynie la sortie du four même du sommeil de je ne sais quelle pâtisserie moëlleuse, ma barbe ne gratte pas trop car mon rasage date de la veille au soir.
Cette chambre en vérité est un étouffoir, nous n'y avons jamais froid malgré les moins trente du dehors, il y règne toujours au moment une tranpiration, une buée moite sur la lèvre supérieure de ma compagne délicieusement semblable à un loir, par le grassouillet de son corps, et Dieu me préserve de trouver un jour emmêlé à mes jambes les raides bâtons squelettiques d'un mâle moustachu, rassurant mais sec, sec, sec. Qu'est-ce qui fait qu'une femme puisse supporter le corps d'un homme ? Combien nous sommes désagréables, taillés comme des charpentiers, bâtis en barre à mine, avec des érections défaillantes - elles me disent, les femmes, du moins la seule que je connaisse et qui les a remplacées toutes, "Vous êtes attendrissants", "nous pouvons vous porter dans notre ventre", mon Dieu se peut-il qu'une d'entre elles ait osé proférer qu'elle refusait d'être enceinte d'un garçon pour ne pas avoir un sexe mâle dans le ventre, mon Dieu once more n'importe quoi.
Puis nous passons au petit déjeuner, et là, d'un coup, c'est le silence : les corps ne se touchent plus. Ni mots, ni caresses, juste l'air abruti de qui a trop dormi, au-dessus d'un bol chaud. XXX 62 02 02 SV 92 XXX
b) les raisons pour lesquelles nous y sommes, (trois pages) le froid ou le chaud selon les saisons, et
1) invariablement les connards qui nous hébergent,
2)nous leur devons de l'argent et des services, voilà pourquoi nous sommes là, tous les ans depuis des années,
3)je n'ai jamais pu déterminer si mon mec (je ne suis pas homosexuel, nous nous débrouillons chacun de notre côté) couche ou non avec le mâle, cf. aussi le bossu d'Issigeac et cet hôtel abandonné.
I, b, 1) invariablement les connards qui nous hébergent.
Soixante-dix, quatre-vingts fois que s ais-je, nous avons débouché dans cette salle sentant la cendre hiver comme été, frissonnant sous nos longues robes de chambre et invariablement trouvant les toasts juste saisis à point, ou ramenant sur nous les pans inusités de nos habits de vie, car nous couchons nus et ne noue réajustons que pour des besoins de décence. L'été, la porte s'entr'ouvre, et déjà, quelle que soit l'heure, nos hôtes sont là, invariablement souriants et humains, et comme nous sortons de notre tendresse personnelle, ce petit-déjeuner agit invariablement comme un viol : comment d'autres êtres que nous peuvent-ils s'aimer et avoir croupi au lit, le leur, comme nous, avec d'autres choses à se dire ou à ne se point dire ?
Le grand maigre, taciturne, ouvre et ferme ses longues mâchoires de crocodile, non si bien endentées cependant. Il mange salement, avec des claquements, je guette invariablement les pluvians nilotiques picoreurs de canines. Je hais ces gens et leur suis attaché si viscéralement que je ne sais plus que penser : ainsi de l'homme, ou de la femme, qui partage ma couche. La boulette de graisse qui sert de femme à notre hôte tourbillonne autour de nous en imitant, à la lettre, la chouette: c’est-à-dire non pas ce doux ululement du hibou,mais cette criaillerie de l’oiseau nocturne dépeçant sa proie. Depuis, à mon compagnon comme à moi, il n’est croissant si chaud ni moelleux qui ne rappelle un goût de rongeur mort.
Parfois lui et moi partons dans ces bois, à la tombée de la nuit, nos fusils cassés à la main, malgré l'interdiction formelle des autorités du Saskatchewan : tout est si isolé ici. Nous feignons de pousser les cris du hibou, il nous est répondu par nichées entières alignées sous le long ciel arctique. En vérité nous sommes surpris, même rageurs, de ne point voir sur la branche à peine distincte ne fût-ce qu’une ombre tutélaire de rapace. Nous rentrons seuls, une mort délicieuse dans l’âme, et dès la haute tour hantée par le vieux couple, comme une porte refermée, nous refermons d’un seul déclic nos deux fusils.
Décidément, mon compagnon de nuit est un homme. Mais nous ne nous touchons pas de la nuit. Il est des obscénités qu’on ne commet pas. Nous couchons casqués et bottés. Ce lit de fer, c’est une tranchée. Il y a eu beaucoup de viols, réussis ou tentés, entre hommes, devant Verdun ou sur le front de Somme. Ici, contemplant devant nous nos virilités sur le râtelier de bois, nous appesantissons nos paupières, et sombrons dans le plomb jusqu’au petit matin. J’ouvre alors le volet qui bat sur le mur, je sens monter les effluves de chicorée amère, déjà la chouette humaine nous informe que tout est près, ajoutant quelques crouacs qu’elle croit de très bon augure. Alors éclatent entre les deux hommes que nous sommes, renfilant nos pantalons sans nous laver pour descendre décents, de sourdes scènes entre nos dents rentrées.
2)nous leur devons de l'argent et des services, voilà pourquoi nous sommes là, tous les ans depuis des années,
(une page)
Nous venons d’Edmonton, au sud. C’est sans originalité. Nous ne devrions pas appeler réellement cette ville « Edmonton », qui existe réellement. La nôtre se perd au milieu d’un désert froid, touffe de gratte-ciel où personne n'aurait la moindre idée de précipiter un avion. Les silos qui la cernent atteignent en perspective une hauteur extrême, l'ensemble fermentant sous le regard obtus des thermostats lumineux. Mais tous les étés, tous les automnes, tous les hivers aussi (les déneigeuses du cru démontrent leur efficacité) (il n’y a qu’au printemps que la boue empêche tout) - nous ramènent chez Jywes et Holly, son épouse.
Nous nous y sentons obligés. Nous sommes leurs obligés. C'est pour nous qu'ils ont acheté cette haute maison, qu’ils appellent entre eux « la Masure », alors que rien, strictement rien ne les y obligeait.
Mais comme ils ont bien vu que rien ni personne ne nous ferait mettre « la main à la pâte », que décidément nous n’étions pas dignes de ce somptueux cadeau injustifié, ne sachant ni l'un ni l'autre bricoler quoi que ce fût ni passer une couche de lasure ou de fongicide, ils se sont sentis obligés d’occuper la masure, de l’entretenir, d’y passer couche de brosse sur couche de brosse, goudron sur goudron, de clouer bardeau sur bardeau, volant sur volant. Ils avaient eux aussi leur petite maison bien cernée de pelouse, en banlieue, ils partaient à la pêche au Lac des Esclaves, la température descendait - mais ici, c’étaient eux qui entretenaient la Masure qu’ils nous avaient offerte.
Est-ce qu’il ne s’était pas agi, à un moment donné, de Dieu sait quel billet de loto gagnant que nous aurions partagé, est-ce que nous n’avions pas jadis échangé nos femmes ou nos maris, n’y avait-il pas entre nous de ces secrets de sectes et de communautés toutes antérieures à janvier 73, Canadiennes ou pas... Seuls les survivants de ces temps confus peuvent se figurer correctement le caractère indissoluble de tels liens – ainsi, sentir se glisser en vous une queue subreptice – d'où l’inconcevable éventualité de toute rupture ; le silence qui tombe sur vous pendant les années de l'après-vie ; les folies qui vous font soudain chuinter comme une chouette ou boubouler comme un hibou ; culpabilités molles, traînasseries, désespoirs jouissifs qui s'immiscent à l'heure où le vent faufilé dans les cimes redescend heurter les volets.
Ce sont les nuits qui comptent ici, d'une épaisseur bien plus révélatrice que ce jour court, au pays de Moose Jaw et de Poughkeepsie, de tous ces lieux sans véritables noms. Une densité morne qui vous plombe d'un coup dans un sommeil où l’on ignore qui rampe entre vos jambes : si c’est un homme une obstination raide sous le tissu sale d’un falze désastreusement immobile.
De notre chambre à la salle à manger d'en bas, il n’y a qu’une échelle-de-meunier, trompe-la-mort pour chiards, barrée d'une sécurité dont seuls les prétendus adultes possèdent la clé. Nous explorons aussi les étages supérieurs. C’est comme dans un rêve. Nous ne sommes pas déshabillés. Nous portons nos flingues cassés le long de la hanche, nous montons les yeux fixes dans le noir, où nous avons acquis le regard nyctalope des rapaces que nous échouons à trouver. Ce sont des chambres vides deux par deux superposées, comme si en vérité le bâtiment se haussait à mesure, s’érigeait tandis que nous découvrions les pièces délaissées, les lavabos gouttant dans la nuit, les draps roulés là ou défaits, les matelas entoilés croisant leurs rayures, les ampoules salies de chiures que nous allumons, blafardes et grésillantes, bien plus propres à effrayer qu’à éclairer, tandis que s’ébranlent dans nos dos, loin au dessous de nous mais d’autant plus effrayants je le répète en vérité que s’ils étaient là tout proches à nous toucher, des lourds usufruitiers qui nous demandent ce que nous pouvons bien foutre là-haut, à gaspiller de l’électricité, à voir quoi, bon Dieu, puisqu’il y a longtemps qu’il n’y a rien à voir depuis le temps que ce foutu hôtel est abandonné, à moins qu’ils ne nous demandent de les payer enfin pour tous les travaux d’entretien qu’iils voudraient que nous fissions, auxquels nous autres chasseurs nous ne condescendrons jamais, jamais.
Nous savons qu’ils entraîent avec nous, dans la chasse aux escaliers, cette créature qu’ils relâchent la nuit et hante les bas-fonds deleur cave, non point l’exquise Ligéia enterrée vive, mais ce bossu par-devant, bossu par-derrière, bitord en termes techniques, ramené de leur infecte banlieue proprette... Cet homme, Vercassis, exerce en banlieue la profession suivante : modèle pour nain de jardin. Il teint son nez, son visage, de vermillon. Iil prend lesp ostures lesp lus difformes et se fait ainsi photographier. Puis les plasticiens prennent modèle sur lui, reconstituent son image par ordinateur (« D.A.O. ») et le revendent sous forme de figurines.
Se voir poursuivi dans l’escalier de nuit par un tel monstre nous flanque à touts les deux, mon chasseur et moi, des terreurs indicibles : car parfois, dans notre essoufflement, nous voyons son nez de grotesque polichinelle passer le tournant du colimaçon, et nous accélérons, et les étages s’élèvent toujours. Que va-t-il advenir de nous ? Ni mon Chasseur ni moi ne savons planter un clou. Jywes et son épouse suivent à grand bruit trois étages plus bas. C’est tout le bâtiment de style norvégien qui s’ébranle ainsi au milieu de la nuit. Nous savons qu’après la mort de nosp rotecteurs, le bâtiment restera quelque temps à peu près bien entretenu, puis qu’il s’affaissera sur nous, peu à peu avec les années, puis tous, hommes de chair et bâtiments de bois, rentreront sous forme de sciure dans le vaste cycle de la nature.
Nous reviendrons à Edmonton (Saskatchewan) pour le printemps. Nous prendrons des cours de bricolage et de charpente. Nous rétablirons le courant électrique de façon satisfaisante, pour que les lampes sans abat-jour cessent enfin de trembloter comme autant de paupières.
c) élargissement de l'espace, sorte de vaste palombière aux ramifications immenses, cf. l'hôtel d'Issigeac à l'horizontale.
Cette partie est devenue inutile, car tout a déjà été développé dans les paragraphes précédents, avec force détails.
2) L'effondrement
1° alors que je me balade, effondrement d'une aile,
2° une illustration de la collection "tremblements de terre et catastrophes naturelles"
3° je sais qu'il y a qq dessous, je décris les bâtiments,
I, 2, a : une page
D
·0 eux chemins s’échappent de la clairière où Juwes incessamment promène sa silhouette chevaline sur sa tondeuse ; les deux chemins descendent raidement, de part et d’autre à peu près de la haute calvitie que surmonte la bâtisse. Il faut avec entêtement lutter contre la descente avec autant d’obstination qu’on en mettrait à gravir, tant les buissons, les ronces, les végétaux piquants en général vous retiennent au passage, vous protègent de la chute, ainsi qu’une mère abusive, agrippante. C’est le chemin du sud qui vous retient le plus. Au Nord, la pente plus douce menant au Grand Lac des Esclaves caresse d’abord l’épaule à travers le tissu, au point qu’on souhaiterait être nu, par de hautes fougères arborescentes ; il se dégage alors de ces petits champignons éclatants (qui éclatent lorsqu’on les foule) un parfum pénétrant de spores, éjaculation végétale, poussière balsamique : la voix mâle, opposée à la voie femelle ?
·1 Et je les parcourais, alternativement, déplorant le peu d’espace offert par ces bois ancestraux, tandis que mon compagnon le chasseur reposait tout raide auprès de son fusil. Je songeais à cette arme entre nos corps placée comme à l’épée qui sépare Tristan d’Yseut dans la légende du Morrois. C’était la pente sud ou « femelle », et mes nombreux passages rendaient chaque fois moins piquants mes agrippements, lorsqu’il me sembla ouïr un craquement sourd et proche à la fois et lointain ; la terre ondulait sous mes pieds, des éboulements se distinguaient dans les impénétrables fourrés qui m’enclosaient.
Remontant alors avec essoufflement, parfois les deux mains à terre, je pressentis que le Bouclier Hercynien, qui se croyait à l’abri des séismes, subissait une secousse improbable et réelle. Tout le monde a déjà ressenti cela : sensations de nausée, êrte d’équilibre, perte de tout repère, l’angoissante question métaphysique de sa propre existence (« Je ne suis qu’un point,, une poussière près de l’engloutissement ») - il y a dans cet abandon à l’infini une douceur elle aussi infinie, comme celle qui vous prend lors des endormissements. Je voulais courir vers la cabane, dont plusieurs tournants me séparaient au plus épais des fourrés.
Les arbres craquaient, ils ne s’abattaient pas. Ils fourniraient le bois de mon cercueil, je serais enseveli parmi eux. Il existe au Canada de ces espèces balsamiques, remontant à des siècles, et de génération en génération, à des millénaires. Peut-être des gisements de houille hantent-ils ces sous-sols, mais qui planterait des chevalets d’extraction au milieu de ces arbres millénaires, tout chenus de bavures de lianes argentées ? Je regrimpais péniblement la pente. C’était comme un jeu. Les forsythias de là-bas m’écorchaient le creux des mains. Les branches basses se dérobaient à mon étreinte, semblaient voulori m’entraîner dans une valse infernale et facétieuse.
Puis le sol recouvrait sa stabilité. Je courais sur les aiguilles de pins ou d’épicéas, bien rangées et bien sèches. Puis tout réondulait comme la peau d’un serpent, le perfum était pénétrant, un nouveau tournant se précisait entre les buissons bas. C’était un amour merveilleux avec la nature, quelque chose de dangereux et d’affectueux, comme d’uen mère éléphant avec un chaton. Mais ces gros animaux sont capables de délicatetsses inimaginables. Je ne risquais rien, à moine que le démon n’ouvrît sous moi une de ces crevasses d’engloutissement, aussi vite refermées qu’ouvertes.
2° une illustration de la collection "tremblements de terre et catastrophes naturelles"
Une page
Le bâtiment, quand je le vis, m’offrit l’image d’une invraisemblance absolue. Comment avait-il pu se faire qu’une surface aussi réduite au sol n’eût pas provoqué un effondrement « en château de cartes » ? Les mouvemets du chat, ou de l’éléphant, ou de la tortue (disent les Japonais) sur lesquels nous vivons, vermine humaine, sont rigoureusement imprévisible. Une partie du bâtiment restait vigoureusement intacte. C’était la moitié sud-est. Les étagements de bois, les volants de jupe ligneuse restaient fix »s l’un sur l’autre comme autant d’écailles intactes. D’un coup, au-delà d’une flèche de bois plus capricisues, que la secousse avait amené à la verticale, toute la maison du sommet de Mount Shyle s’était affalée au nord-ouest, en direction de l’Alaska. C’était comme un épine dorsale brisée, un long chevauchement de chevalets d’échine, un espadon mille fois rompu et rerompu, un léviathan fossile mal classé encore par les paléontologues, comme si le tremblement de terre s’était produit vingt millions d’années avant notre ère, et que les morceaux d’un ichthyosaure - les mots m’échappent, comme la terre sous mes pieds. La sciure planait par-dessus tout cela. L’odeur était merveilleuse, les particules demeuraient suspendues à deux mètre ou trois au-dessus du sol, et répandaient cette saveur de bois qui détermine les vocations de forestiers for ever, quel que soit le bas salaire qu’on obtienne dans ces professions déshéritées, loin de tout.
Un journaliste pressé -j’aurais pu vendre très cher mon reportage, mes clichés si j’avais eu l’esprit de porter sur moi un Nikon 400 E - « Je devrais me barder d’appareils photographiques, ces deux sentiers sont si riches que je rapporterais au poins de quoi garnir deux albums » - et puis j’oubliais - aurait alors mitraillé cette scierie bombardée,ce chaos d’éclatures où subsistait le grand dessein d’un architecte. Nulle fumée ne s’élevait encore, à l’exception de cette écharpe odorante et blonde, et c’était merveilleux, en vérité, que nul incendie ne se fût déclaré, ni ne menaçât, car mon odorat était aux aguets. Tous les sens jouissaient e la perspective eshétique offerte à moi. Les oreilles jouissaient d’une sorte d’écho : de là où j’étais, les arbres bienveillants m’avaient masqu » le bruit de l’effondrement, qui avait dû se produire très lentement, comme un froissement de vent dans les feuilles. Je me penchai pour cueillir au bout de mes doigts de cette matière merveilleuse, et je pensais qu’ainsi s’effondrent les empires, il n’en reste plus que le parfum qui pour toujours entête les civilisation à venir.
Des champignons, des insectes, se repaîtraient de cette sciure. J’étais subjuguée, transformé en femme, ouverte à toutes les sensations. Enfin, pensais-je, notre prison n’existe plus. Je ne pensais pas : « Comment vais-je réapprendre à vivre désormais ? » Non, la destruction, préalable à toute renaissance, m’apparaissait dans toute sa bienfaisance. Je longeais ces « poutrelles désaxées », ces planchers désormais verticaux, j’évaluais en connaisseuse ‘désormais j’étais femme, pour un certain temps, je priais l’intérieur de moi-même pour que cet état divin se prolongeât, car la femme est proche du divin autant que le sommet s’affale à terre et en épouse les contours) l’angle, techniquement parlant, 25° ? 45 ° ? où tous ces enchevêtrements se présentaient.
Et rien, Dieu merci, n’était reconnaissable, ni la chambre, où trônaient les hideuses images, ni la chambre des deux monstres, l’homme et la femme encore condamnés à leur sexe respectif, seule peut-être la tondeuse à gazon osait montrer son large siège de cuir en forme de cul : je voyais les deux étroites ellipses dessinant sur le cuir la marque des fesses d’un certain Jywes.
3° je sais qu'il y a qq dessous, je décris les bâtiments, une page
Alors seulement j’acceptai de penser aux humains. Qui était vivant, qui était mort ? Le cheval maudit, l’homme à la tondeuse ? Notre hôtesse, la graisseuse, toujours à virevolter au milieu de ses tartines ? Mon compagnon le chasseur, sale et raide dans ses pantalons militaires, et qui ne me touchait jamais pendant la nuit ? Je ne l’aurais pas suporté : qu’il se lavât, d’abord. C’était vraiment, j’y revenais toujours, l’odeur qui m’emplissait tout entière, du poumon à ces cavités que je sentais, nouvelles et palpitantes, désormais vivre en moi - mais pour combien de temps ? Mon Dieu, faites que mon changement de sexe se confirme ! La sciure me pénètre par tous les pores. A la moindre odeurde cadavre, d’ici quarante-huit heures je suppose au plus tard, je sens que je redeviendrais un homme.
En même temps, quelque chose s’agitait dans mon esprit : « Tu n’es pas raisonnable. Tu es monstrueuse. Tu jouis du spectacle, tu palpes le bois frais, sans t’inquiéter de ceux qui vivaient là, qui se préparaient à vivre une de ces merveilleuses matinées solitaires. Tu aimerais, n’est-il pas vrai, qu’ils revécussent, qu’ils revinssent à la vie, afin de reprendre cette histoire qui ne t’avait jamais appartenu...
Tout est trop calme. Il ne règne absolument pas d’atmosphère de mort. Une heureuse coïncidence a fait que tous auront survécu. Je me fais peur. Il n’y a pas de mal. Ils sortiront de leur cage de bois, soit de la partie miraculeusement restée intacte, soit de cette longue avancée disloquée. Et c’est d’abord le cheval funèbre, le chevaucheur de tondeuse à gazon, qui s’ébroue de sa sciure, tout près de la base, où le poids a pesé le moins. Il me regarde hébété, les bras ballants. Il ne trouve rien à me dire, ses lèvres sont retroussées exactement comme celles d’un cheval sur le mort, je vois ses dents jaunes dont je détourne toujoiurs le regard pendant les petits-déjeuners si copieux.
A mon grand désespoir, à mon grand soulagement - comment définir ces deux choses, là, juxtaposées ? - je vois la boulette sortant par la demi-porte restante, car la catastrophe l’a surprise au milieu des étages. Elle était en train de manger, les lèvres lui dégoulinent encore de sirop d’érable. Pourquoi les tremblements de terre n’éliminent-ils jamais ceux envers lesquels nous sommes redevables ? Pourquoi me trouvais-je si proche, dans un chemin creux, encombré de buissons ? Où est mon chasseur ? Il étire son long cou de l’autre côté du bâtiment, il revient lui aussi de promenade, il a pris le second sentier, vers le nord, il ramène par les ouïes une carpe à demi morte, que l’affolement a jetée sur sa ligne,
-
Cette rue-là
C O L L I G N O N
C E T T E R U E – L À
Cette rue-là : ma rue. Je n'y habite pas mais l'emprunte à peu près chaque jour. Elle commence à cinquante pas de ma maison, bicoque irréparable, pour s'achever place Capeyron, rebaptisée "Jean Jaurès", moins pour honorer le grand homme que par conformisme, comme on a une rue Jeanne d'Arc ou Victor Hugo. Là se trouvent les petits services ou commerces (poste, café, boulangerie). J'entreprends à mon âge ce que la société jointe à ma flemme ne publiera pas.
Il semblera peu indiqué d'introduire ici, sans lien avec ce qui précède ou suit, un vademecum de toute une vie envieuse, suintant de haine recuite et de mauvaise foi. Le but poursuivi est de fournir un efficace contre-poison à toutes ces Lettres à un jeune poète plus ou moins bien recyclées que l'on assène en début de carrière à tous ceux qui postulent à la gloire ou plus modestement à la reconnaissance, et dont le souci essentiel semble de conserver entre les mains avides d'auteur tout le bénéfice de notoriété, en submergeant le néophyte de toutes espèces de considérations sur la difficulté extrême d'entreprise, et les conditions de grandeur et de modestie qu'il faut avoir patiemment cultivées, ce que l'auteur a fait, mais dont toi, pauvre larve destinataire, tu ne parviendras jamais à te rendre digne.
La gloire en définitive, c'est comme l'argent ou l'érection : ne pas en avoir, ce n'est pas si important.
Rompez.
Apprenez ceci, et faites comme il vous chante : resservir les Conseils de Rilke à un jeune poète relève d'Aa mahonnêteté intellectuelle, tant ces époques semblent désormais préhistoriques... Je dirais : décidez-vous vite, virez dans le book-business, un emploi vite n'importe lequel, soyez pute-pute-pute, le pied dans la porte, pour les filles vous couchez on vous le publiera votre manuscrit et même on vous l'écrira pourvu que vous écartiez bien les cuisses sous le stand du Salon, n'importe quel fond de tiroir les sujets bien bidon sana vagues – solitude cancer bons immigrés c'est vendeur – mais si vous vous êtes un instant figuré que vos sentiments meurtris et votre timidité de couille sèche vous ouvriront l'accès Allah Publication retournez donc vous branler sur votre tas de paille tout est complet occupé comme une chiotte tu ne vas pas t'amener comme ça devant l'usine à yaourts avec ton petit pot perso dont tout le monde se tape. Le coup du "comité de lecture" et du "manuscrit envoyé par la poste" dire qu'il y a encore des cons pour le croire et des salopards pour le faire croire jusque dans les livres scolaires c'est à désespérer de l'intelligence humaine MOI j'ai assisté aux comités de lecture, le mec sort la première phrase avec l'accent belge au suivant avec l'accent arabe suivant japonais pédé bègue suivant suivant suivant qu'est-ce que t'attends pauvre con de timide va te jeter dans la Seine et ne remonte jamais.
Ce qu'il vous faut jeunes gens just what you need c'est d'être superbien dans sa peau bonjour à tous et sourire, "l'écriture y a pas que ça qui compte", "l'important c'est de parler avec les Gens, les Aûûtres", si excitants. Laissés-pour-compte, timides, authentiques – allez vous faire foutre. Le milieu, on vous dit, se faire bien voir et bien se faire voir, ne pas dépasser ne pas se dépasser, avoir bien négocié le virage 20-25 ans, choix du métier choix du partenaire – mais qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'elle lui trouve – c'est mon choix qu'ils disent et quel que soit leur "niveau d'études" – ô chers couillons de profs, chers boy-scouts si sottement persuadés de votre influence -
- jeunes ! jeunes ! si vous n'avez pas intégré la profession du livre ou du baveux, d'Aa télé ou du ciné, ce sera jamais à tout jamais pour vous, si vous n'avez jamais connu Un d'Aa Mafia intimement et avant – car le premier commandement qui leur est fait aux mafieux, dès leur intronisation, c'est de ne jamais, plus jamais accorder leur amitié, exactement comme les femmes mariées d'Aa bourgeoisie se seraient crues déshonorées si elles avaient révélé si peu que ce fût sur la sacro-sainte Nuit de Noces, à savoir une grosse bite fourrageant sauvagement dans un pauvre petit sexe de femme tout meurtri. Et aucune jeune fille de ce temps-là n'en a jamais rien su. De même, le réseau des maisons d'édition, soigneusement verrouillé, s'obstine-t-il plus que jamais à répandre auprès des jeunes lycé-huns et haines des informations fausses, telle cette ignoble légende du "manuscrit-envoyé-par-la-poste" qui fait se boyauter jusqu'au dernier sous-directeur de collection – pauvres, pauvres élèves... Bref, je ne me suis pas fait admettre parmi les milieux littéraires, je n'ai pas rencontré André Breton (il n'avait que ça à foutre, André Breton : se balader comme ça sur les trottoirs pour pistonner les débutants) – "mon succès, je le dois à mes rencontres !" - soigneusement arrachées, lesdites rencontres, même au sein d'Aa Mafia, au terme d'Aongues, farouches et tortueuses négociations - "il rencontre Marcel Bénabou, il devient documentaliste au CNRS" – alors voilà : on va dire du mal, je ne dis pas de mal de Pérec, je dis du mal de toutes les réussites en général.
Il n'y a que ce sujet pour enflammer la conversation. Liste des maisons dignes du souvenir :
- les Blot – la Doctoresse – le bourrier – le Six, ex-Mousquet, la mère Bourret juste en face – le vieil Arménien du pressing et son fils – l'ancien garage des Birnbaum – la bicoque rénovée en fausse meulière ; chez Barcelo – la pharmacie – le petit labo : encore la rue Mazaryk (nous étions deux vieux dans l'histoire, la femme et moi – autant dire que la rue d'Allégresse proprement dite ne montre que des pavillons totalement dépourvus d'intérêt.
* * *
La rue d'Allégresse rejoint l'avenue Gindrac à la rue du Niveau. Gindrac est un stade tout vert, où parfois les Minimes de Cingeosse affrontent SPTT Junior à grand renfort de projecteurs et de haut-parleurs. Le Niveau, c'est l'emplacement d'A'octroi, d'une grande bascule au ras du sol où s'effectuait la pesée des fardiers, tirés par leurs grands limoniers. La rue d'Allégresse monte en pente imperceptible. Fier-Cloporte habite plus à l'est, après la place triangulaire toute malcommode : au 5 Avenue François-Joseph, "Empereur d'Autriche et roi de Hongrie" (c'est sur le panneau) – 1830-1916 – pourquoi ici une Avenue François-Joseph ? pourquoi rue d'Allégresse ? une de ces dénominations d'A'ancien temps, le temps naïf et grandiose où les faubouriens de Liège s'en jetaient un petit au zinc "du Commerce et de l'Industrie", au coin pourquoi pas "'Impasse de la Fraternité.
Dès les premiers pas le piéton passe au droit des panneaux "Résidence Allégresse", "Propriété privée", "Voie sans issue", superposés. Je n'entre jamais. Prenons tous les jours ou presque, seuls ou en couples,la direction de ces petits commerces Place Pérignon ou "Jean Jaurès" puisque "Jean Jaurès" il y a mort en 1914. Trottoirs de terre battue, perspectives plates et pavillons sans grâce. Les Mousquet s'y sont promenés jusqu'en 97 où le mari mourut chez lui d'une chute au réveil ; lorsque les secours ont passé la civière entre les battants d'Aa fenêtre un jeune infirmier répétait en boucle faut pas vous en faire PAPY ce n'est rien puis ce fut le tour d'Aa survivante aller-retour sur ses jambes en poteaux, octogénaire et chaloupant son abdomen sans une plainte. Ils ont bite au fond du jardin une bicoque insalubre, vue imprenable sur la clôture, télé à fond je l'allume pour avoir du bruit loyé payé ponctuellement bouclant les fins de mois du proprio, visite mensuelle de prélèvement, vingt-cinq minutes de conneries appelées "bavardage". Dernières déclarations du Mari Papy n'oublie pas le gros lapin pinpin dans son clapier rue d'Allégresse au bout à gauche et pis t'es mort, imbécile et grandiose. Le pinpin vaut bien Du haut de ces Pyramides jamais jamais dit par Buonaparte.
On trouve rue d'Allégresse des renfoncements secrets avec des lapins tout au bout, des couloirs extérieurs sous voûte s'élargissant soudain en cours, en sentier, en prairie de ville ou petits carrés bien bêchés dans l'herbe dite "folle".Derrière des façades fades une porte en bois de passages dérobés d'une rue l'autre ; pour aller chez la Veuve Mousquet il faut passer par un sentier de ciment sous les glycines au sécateur une servitude en langage foncier, pousser la claie du jardinet puis marcher sur l'herbe jusqu'au mur moisi : la bande dessinée – nettoyage obligatoire irrégulier des branchages, feuillages, excréments félins, cailloux et noyaux de pêche sinon SINON le proprio devra payer pour le col du fémur, payer pour le fauteuil payer pour l'hosto payer pour les zobsèques. .
Beaucoup reste à construire. Les prix s'envolent mais qui achètera la parcelle où vivote et végète une mère et grand-mère de nonante ans ? Non, la rue d'Allégresse n'émet pas d'atmosphère étrange pas même originale. Une rue vide tout au plus avant travaux, sans parfum ni densité. Tel ce triangle de trottoir aux de tiers de longueur devant paraît-il un ancien garage, d'où déboulent sur trois tricycles trois gosses têtes à claques en dérapant sur le sable-et-gravier non coulé – juste ce fragment de rêve : à cinquante ans d'ici c'était les ploucs.
Oui les passants sont nonchalants. "Chez Grigou, escaliers, menuiseries" allée privée (trois maisons cossues, laquelle est "Chez Grigou" ? Le proprio du "terrain Mousquet" pense un jour demander aux trois gendres de remplacer, faire sauter, la petite claie à claire-voie entre sa plate-bande à lui et le terrain vague herbeux qui rampe jusqu'au mur de la bicoque-à-vieille "un certain charme" – pourvu mon Dieu qu'elle ne se casse pas la binette un jour "ou peut-être une nuit" sur ces 18 débris de bois spongieux désassemblés tout verdâtres qui ne ferment plus, qui se dandinent en grinçant dans les coups de vent. La Nonamousquet dit qu'elle tiendra "bien autant que moi" "mais peut-être bien madame Mousquet (jamais "Mamy" ni "Mémé") vous nous enterrerez tous avec vot' portillon" – rue d'Allégresse qui ne sait rien des habitants ne sait rien de la rue, mais justement ! les habitants n'intéressent personne...
Jamais. Je n'ai que des maisons. Rien à foutre des gens. Sauf quand ils habitent au fond du jardin. Un effort à faire, c'est tout. Nous n'allons pas imaginer une histoire par bicoque. Ce n'est pas du Perec ici. La rue de l'Allégresse ne rappelle rien. Rien du tout. Un passage ; impersonnel jusqu'au délire. Les morts y passent. Il s'appelait Margolis. Avec ses bretelles, sa ceinture, son chef-d'œuvre Jardin Public rebaptisé, imprononçablement, Les îles Faults. De la prétention, un bon lainage, un bon roman, la mort - Véra F., aussi. Qui est morte. Passer devant sa boutique en se disant Pourvu qu'elle ne me voie pas ou j'en ai pour une heure. Plus de problème. Prochain bavardage de l'autre côté. Sur sa tombe, une gerbe rouge éclatant, toute rectangulaire, àplat sur le sol, ces derniers temps elle n'avait plus que la peau et les os. Je lui ai parlé de moi au-dessus de la gerbe et du bon côté de la terre, et sur les bouquets de côté on lisait À Nicole – Tu savais, toi, qu'elle s'appelait Nicole?
Sur des rubans roses. On dirait une pâtisserie, qu'est-ce que je disais des gens tout à l'heure ? À gauche donc "Cité de l'Allégresse", brèche incongrue dans la rue à l'ancienne seventie's tout le confort puis la vraie rue démarre : entre ses rebords de trottoir, mollement, comme un alignement de molaires qui trébuchent (les gosses ne jouent "à l'équilibre" que sur des bords bien nets, piétinage et radotage sont les deux mamelles du grand âge. Sur ces pierres déambulait le père Mousquet, grand, ilstable. Un jour des petits cons l'ont bombardé de marrons il a gueulé des syllabes édentées tous les gamins ont détalé. Je ne réagis jamais. Une volée de pétards dans les jambes sans tressaillir d'une ligne. Parole il est sourd ! Haïr tout ce qui est jeune avec la même conscience que je haïssais totu ce qui dépassait 35 ans.
Elle a beaucoup frappé la nouvelle de Buzzati où les vitelloni trucident leurs pères avant de se regarder dans le miroir à présent son père c'était lui. Le père Mousquet fut enterré avec drapeaux parce qu'il avait été pompier. Ses deux petits-enfants concoctèrent une petite oraison avec une faute énorme religieusement conservée par l'abbé, qui ne s'est pas rendu compte que sa démagogie correspondait exactement à du mépris faire peuple, c'est mépriser le peuple. L'Église crève d'avoir voulu "faire peuple". Madame Veuve Mousquet écoute la messe télévisée. Tous les étés par la fenêtre ouverte d'avril à mi-novembre bon pied bon œil. Toujours riante et souriante, ravaudant les vêtements des vieux : ça repart, ça revient...
À 8h chaque jour, heure d'hiver, heure d'été, ses volets contre le mur que de maigres moyens ne permettent pas de retaper. Souvent lui téléphoner pour ne pas retrouver unbeau jour son corps "en décomposition avancée" disent les journaux. Qui gagne sous son béret,clopin-clopan, le bout de la rue d'allégresse. Ne pas prendre chaud. Ne pas prendre froid. Revenir. Le jeu consiste à éviter la mère Mousquet. Sans la bombarder de marrons. Du plus loin qu'on l'aperçoit venant à sa rencontre, trapue et vacillante, s'interdire tout changement de trottoir, histoire de ne pas froisser. Échanger des bonjours, des météorologies sur un ton enjoué, poursuivre chacun sa route. Elle a pris l'habitude de ces manières peu causantes. Mon mari était comme lui. Je mène (c'est son mot) une vie "retirée".
Exact. À la dérobée je regarde ma montre sitôt la visite arrivée. La plus grande satisfaction est de passer tout le jour sans l'avoir vue sortir ou entrer. L'essentiel en tout cas est de ne plus croiser personne :judicieux traversements de rue du plus loin qu'on aperçoit quelqu'un. Quelle autre conduite à tenir ? ...détourner le regard, saluer au dernier moment ? Lâcher "Bonjour !" ? Voici l'endroit précis où se situe la moitié de la rue : cela se passe en biais, sur un angle de vingt degrés. Le côté gauche présente à cet endroit une propriété avec de l'herbe, un balcon où l'on monte par de larges marches, une plaque cuivrée : "Le Scouarnec"